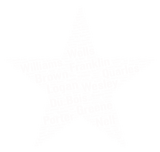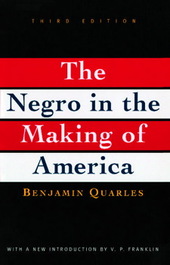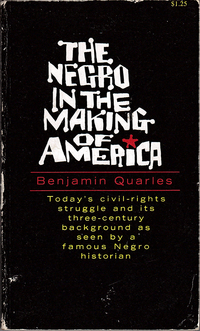
Couverture de la première édition de 1964
Traduction de Laurent Vannini
Coordination de Michaël Roy
Dans la chanson préférée des habitants du Sud, « Dixie », la région est décrite comme une terre de coton. C’est bien ce qu’elle fut, mais pas en tout temps ni en tous lieux, et certainement pas pendant les près de deux siècles ayant suivi la fondation de Jamestown. Le coton fit son apparition à la faveur de la révolution industrielle, pendant laquelle furent inventées les machines qui permirent de l’exploiter puis de le rendre accessible en abondance.
Au cours des années 1700, plusieurs machines furent inventées, en Angleterre principalement, qui révolutionnèrent l’industrie textile en utilisant de nouvelles sources d’énergie. Ce mouvement d’innovation entraîna une nette augmentation de la demande en matières premières susceptibles d’être transformées par les nouvelles machines. À cet égard, le coton était idéal, à condition que les graines fussent séparées des fibres auxquelles elles adhéraient fermement. L’Amérique coloniale avait cultivé du coton, mais dans des quantités infimes, à l’instar de la ville la plus importante de Caroline du Sud qui exporta seulement sept balles de coton en 1748. Ce n’est qu’à la fin du siècle que la recherche d’une machine capable de séparer les graines porta ses fruits ; en 1793, fut inventée l’égreneuse à coton (cotton gin), en grande partie grâce à Eli Whitney.
Rapidement devenue un outil efficace et peu coûteux, la nouvelle machine eut un impact immédiat. En 1804, la récolte de coton en Amérique était huit fois supérieure à celle de 1794. Les restrictions commerciales imposées par l’Angleterre, qui expliquent en partie la guerre de 1812, endiguèrent temporairement la demande britannique, mais une fois la guerre terminée les propriétaires d’usines aux États-Unis et à l’étranger réclamèrent du coton de plus belle. Décennie après décennie, le royaume du coton s’étendit inexorablement vers de nouvelles terres vierges, notamment en direction du Sud-Ouest, où la saison végétative durait sept mois. Une telle expansion fut rendue possible par des acquisitions territoriales telles que l’achat de la Louisiane en 1803 et l’annexion du Texas en 1845. La Floride, acquise en 1819, disposait également de régions de culture du coton, qui dès 1840 produisaient plus de cent mille balles de coton par an. Dans le quart de siècle précédant la guerre de Sécession, les champs de coton du Sud des États-Unis produisaient les trois quarts de la réserve mondiale.
La culture du coton ne pouvait qu’encourager le développement rapide de l’esclavage ; les deux semblaient avoir été faits l’un pour l’autre. À bien des égards, le coton se prêtait au travail des esclaves. Une personne qui travaillait dans un champ de coton n’avait pas besoin d’être très motivée. En plus du sac contenant le coton récolté, ses outils se limitaient à la houe et à la charrue ; aucune des opérations n’était compliquée au point d’exiger du cueilleur qu’il restât concentré sur son travail. La culture du coton fournissait du travail tant aux femmes qu’aux hommes, aux jeunes enfants qu’aux hommes âgés, aux personnes généralement en bonne santé qu’aux malades chroniques. Elle se prêtait à un système de travail en équipes : la taille moyenne de la plante permettait au contremaître de garder chaque travailleur (ils pouvaient être jusqu’à quarante) dans son champ de vision. Il s’agissait par ailleurs d’une plante résistante, difficilement abîmable même lorsqu’on ne prenait aucune précaution. De surcroît, elle fournissait du travail pendant toute l’année.
En 1860, les trois quarts de la population d’ouvriers agricoles noirs cultivaient le coton. D’autres denrées telles que le tabac, le sucre, le riz et le chanvre dépendaient de la main-d’œuvre servile et, comme le coton, fournissaient du travail tout au long de l’année. Mais contrairement au coton, on ne les cultivait pas dans l’ensemble des États du Sud. La culture du tabac avait lieu principalement dans les États qui sont à la frontière avec le Nord du pays (border states), en particulier la Virginie et le Kentucky ; on cultivait le sucre en Louisiane ; le riz en Caroline du Sud et en Géorgie ; le chanvre dans le Kentucky et le Missouri.
Après 1807, c’est la traite des esclaves au sein même des frontières états-uniennes qui permit de satisfaire en partie la demande accrue en ouvriers agricoles noirs. L’importation d’esclaves était devenue illégale le 1er janvier 1808, à la suite d’une loi votée 1 par le Congrès le 2 mars 1807. Le président Jefferson avait demandé à ce que les États-Unis se retirent immédiatement de « toute participation à ces violations des droits de l’homme depuis si longtemps perpétrées à l’encontre des paisibles habitants de l’Afrique ».
C’était une chose de voter une loi ; encore fallait-il qu’elle soit appliquée. Il s’avéra difficile de mettre fin à l’importation d’esclaves en provenance d’Afrique et des Caraïbes. Il y avait d’importants bénéfices à réaliser et les risques encourus étaient réduits dans la mesure où le gouvernement fédéral ne chercha pas véritablement à identifier les contrevenants. Les navires négriers, dont la plupart appareillaient à New York et à Boston, transportaient en moyenne 5 000 Africains introduits par contrebande chaque année. Malgré tout, la loi du 2 mars 1807 freina considérablement l’importation d’esclaves et força les planteurs de coton du Sud profond à effectuer leurs achats sur le marché intérieur. Les États possédant des esclaves en surnombre — la Virginie, le Maryland et le Kentucky — devinrent les réserves du royaume du coton.
Des négociants habilités à spéculer pour vendre et acheter des esclaves servaient d’intermédiaires entre les vendeurs situés dans les États voisins du Nord et les acheteurs issus du Sud profond. Ces négociants acquéraient la plupart de leurs esclaves lors de ventes aux enchères qui avaient normalement lieu dans le palais de justice du comté. Ils inspectaient leurs marchandises potentielles avec beaucoup de soin : ils déterminaient l’âge d’un esclave en examinant ses dents, et cherchaient d’éventuelles cicatrices laissées par le fouet pour savoir si l’esclave était obéissant ou non. Le commissaire-priseur attirait l’attention sur les qualités singulières de l’esclave lorsque celles-ci n’étaient pas détectables à l’œil nu, telles que l’habileté au travail d’un homme ou la capacité d’une femme à porter des enfants. Parfois, le maître qui vendait ses esclaves exigeait que les familles fussent vendues ensemble, ou plus particulièrement qu’un enfant ne fût pas vendu séparément de sa mère. Cependant la plupart des négociants se souciaient assez peu de préserver l’unité familiale des esclaves. Comme l’écrit Frederic Bancroft, « la vente privée ou publique d’enfants en bas âge était fréquente et tristement célèbre ».
Une fois qu’il avait acheté ses esclaves, le négociant devait les acheminer vers les marchés du Sud profond. Les esclaves des côtes de la Virginie et du Maryland étaient entreposés dans les cales des bateaux des ports de Baltimore, Washington et Norfolk dans la baie de Chesapeake, à destination des villes situées le long du golfe. Les esclaves du Kentucky et de l’arrière-pays virginien effectuaient un voyage par la route vers le fleuve Mississippi ; ils dormaient la nuit dans des prisons ou des entrepôts. Lorsqu’ils atteignaient le Mississippi, les esclaves s’embarquaient sur un bac à destination de la Nouvelle-Orléans.
La Nouvelle-Orléans était le haut lieu de la traite négrière : dans ses rues principales, les salles d’exposition jouxtaient les vitrines et les dépôts d’esclaves, auxquels s’ajoutaient quelque deux cents maisons de vente aux enchères, où l’on pouvait se procurer n’importe quel type d’esclave, y compris une charmante octavonne qu’on enverrait ensuite à Paris pour qu’elle y fasse son éducation. Alors qu’il était de passage à la Nouvelle-Orléans, Frederick Law Olmsted remarqua un groupe d’esclaves récemment vendus, qui attendaient le bateau à vapeur devant les emmener vers la plantation de leur nouveau maître. Ils étaient au nombre de vingt-deux, chacun revêtu d’un habit bleu et d’un chapeau noir, et portaient à la main un balluchon et une paire de chaussures. Ils se tenaient droits et silencieux, tandis que les passants les regardaient avec curiosité. « Et dire que la Louisiane et le Texas paient à la Virginie une vingtaine de milliers de dollars pour cette masse d’os et de muscles », écrivait Olmsted.
La traite négrière intérieure concerna en moyenne 7 500 esclaves par an entre 1820 et 1860. Cela ne correspondait pas au transfert total d’esclaves des États vendeurs vers les États acheteurs, car un grand nombre d’esclaves étaient acheminés par leurs maîtres plutôt que par des marchands d’esclaves. En effet, sur les 742 000 esclaves ayant été déplacés des régions les moins rentables vers les régions les plus rentables pendant les quatre décennies avant la guerre de Sécession, on estime à 445 200 (soit trois cinquièmes) le nombre d’esclaves déplacés par un maître qui émigrait d’une région à l’autre. En dépit de son ampleur, la traite négrière intérieure ne permit pas de fournir aux propriétaires du Sud profond des esclaves en nombre suffisant. Ceci explique l’apparition, dans les années 1850, d’un mouvement destiné à réintroduire la traite internationale des esclaves, soit en incitant le Congrès à abroger les lois sur la traite africaine, soit en poussant la Cour suprême à les déclarer inconstitutionnelles.
En plus de la traite négrière intérieure, la pratique de la location d’esclaves permettait à ceux qui en avaient besoin de se procurer de la main-d’œuvre. Concernant environ 60 000 esclaves par an, la location était une pratique courante dans tous les États du Sud, mais elle était tout particulièrement répandue dans les États qui avaient des esclaves en surnombre. Les loueurs d’esclaves pouvaient fournir des Noirs à la journée, à la semaine, au mois ou à l’année.
En règle générale, ceux qui louaient des esclaves en avaient besoin pour effectuer une tâche spécifique ou pour une période de temps limitée. On pouvait par exemple avoir recours à la location pour une entreprise de grande ampleur et de courte durée telle que la construction d’une voie ferrée. On louait également des esclaves dans les industries du fer et du charbon, ainsi que dans les usines de chanvre et de tabac. En ville, les médecins ou les avocats engageaient ces esclaves comme domestiques.
Les esclaves concernés avaient généralement le droit à une nourriture saine et à une tenue adaptée au travail demandé. Témoin cet habitant du Kentucky qui, en 1833, accepta de « fournir à l’homme noir mentionné ci-dessus deux tenues d’été de bonne qualité, une tenue d’automne en toile grossière, et une paire de chaussures ». Dans certains cas, l’esclave recevait une indemnité hebdomadaire de vingt-cinq cents. Certains États permettaient aux esclaves de louer leur propre temps, même si cette pratique était en général réservée aux esclaves qualifiés et dignes de confiance.
Une fois l’esclavage devenu un trait dominant de la vie du Sud, il devint primordial de le préserver. Ainsi les faiseurs d’opinion du Sud— membres du congrès, hommes d’église, directeurs de journaux et professeurs d’université — mirent-ils au point un discours favorable à l’esclavage, qui consistait à voir dans cette institution un bienfait. Les Noirs étaient selon eux biologiquement inférieurs aux Blancs ; la race déterminait les traits moraux et mentaux. Puisqu’ils appartenaient à une race inférieure, les Noirs étaient destinés à devenir des esclaves. C’était là leur condition normale et naturelle.
Les chefs de file du Sud d’avant la guerre de Sécession ne croyaient pas en une société ouverte. Pour John C. Calhoun, il était faux et dangereux d’imaginer que tous les êtres humains disposaient d’un même droit à la liberté. Un autre homme politique influent, le sénateur de Caroline du Sud James H. Hammond, poussa le point de vue de Calhoun jusqu’à sa conclusion logique : « Dans tout système social doit exister une classe chargée des tâches subalternes, des corvées de la vie. » Ce rôle de classe subalterne revenait naturellement aux Noirs, désignés dans les codes noirs comme des « biens mobiliers ». Un autre argument reposait sur l’idée que les Écritures justifiaient l’esclavage ; aucun des prophètes de l’Ancien Testament ne le condamnait, et Paul conseilla même à un serviteur de retourner auprès de son maître. Un grand nombre d’hommes d’église sudistes se confortaient dans l’idée que la servitude terrestre des Noirs n’était qu’un prologue nécessaire à leur émancipation dans la Jérusalem céleste.
Pour les Blancs du Sud, l’esclavage n’était pas qu’un mode de vie économique : c’était aussi un système de contrôle racial. Libérer les Noirs, c’était prendre le risque de libérer une force incontrôlable qui ne manquerait pas de dégrader la société dans son ensemble. Ainsi l’esclavage était-il un moyen de garder la main sur la population noire et de faire en sorte que le Sud reste « le pays de l’homme blanc », où régneraient la paix, l’ordre et la stabilité.
Les Blancs du Sud étaient par ailleurs convaincus que les Noirs eux-mêmes avaient tout à gagner de l’esclavage. Le défenseur le plus éloquent de cette idée fut de loin l’avocat virginien George Fitzhugh, auteur de deux ouvrages à succès, Sociology for the South 2 et Cannibals All ! 3. Dans ce second pamphlet, Fitzhugh écrivait :
Les esclaves noirs du Sud sont le peuple le plus heureux, et, en un certain sens, le plus libre du monde. Les enfants, les personnes âgées et les infirmes ne travaillent pas du tout, et pourtant ils bénéficient de tout ce qui est nécessaire à leur confort quotidien. Ils jouissent de la liberté, parce qu’ils ne sont opprimés ni par l’inquiétude, ni par le travail.
Le point de vue selon lequel le Noir asservi était le plus heureux des êtres était répété en toute occasion. Dans une affaire jugée en Caroline du Sud en 1853, la cour nota que le Noir libre Reuben Roberts faisait beaucoup plus que ses vingt-quatre ans, et ajouta qu’il « a souvent été constaté que les Noirs paraissent plus jeunes lorsqu’ils sont en esclavage que dans d’autres circonstances ».
Il est difficile de parler de la situation de l’esclave en des termes généraux, car l’esclavage était à la fois un système de travail et un ordre social. Pour comprendre ce que vivait un esclave au quotidien, il faudrait par ailleurs comparer sa situation à celle de la main-d’œuvre pauvre en d’autres lieux, dans le Nord et dans le Sud. Si on se limite à comparer les esclaves entre eux, on peut toutefois affirmer que la situation de l’esclave dépendait en grande partie du travail qu’il effectuait et de la disposition de son maître.
On trouvait des esclaves dans la plupart des régions du Sud, depuis le Delaware jusqu’au Texas. Certains d’entre eux travaillaient en équipes sur de vastes plantations où l’on produisait du coton, du riz, et du sucre, la pénibilité du travail variant de façon importante d’un endroit à l’autre. D’autres esclaves agricoles travaillaient sous la supervision immédiate de leur maître, dans des fermes produisant du tabac et du chanvre. Parmi les esclaves qualifiés, la situation n’était pas la même selon qu’ils travaillaient sur une plantation ou à la ville. Certains esclaves travaillaient comme domestiques, sur les plantations pour la plupart d’entre eux, mais aussi parfois en ville.
Les conditions de vie de l’esclave reflétaient plus ou moins la personnalité du maître, c’est-à-dire ses traits de caractère et son tempérament. Pour certains maîtres, le bonheur et le bien-être moral des esclaves importaient peu ; pour d’autres, ils étaient fondamentaux. Chaque État disposait de lois régissant le traitement des esclaves, mais il revenait la plupart du temps au maître de les appliquer ou non. Un maître bienveillant pouvait ne pas appliquer une loi qu’il jugeait tyrannique, tandis qu’un maître intransigeant pouvait contourner une loi jugée trop clémente.
Le sort d’un esclave dépendait en partie de la richesse de son maître. Sur un total de près de 400 000 propriétaires d’esclaves en 1860, plus de la moitié possédait quatre esclaves ou moins. En général, un esclave appartenant à un petit propriétaire travaillait aux côtés de son maître ; il lui arrivait même de s’asseoir et de manger à sa table. Cette intimité pouvait parfois engendrer un sentiment de respect mutuel. Cela dit, un maître sans grandes ressources était souvent amené à manquer de nourriture : il avait alors recours à des mesures d’économie dont les esclaves noirs étaient les premières victimes. Quoi qu’il en soit, il semble que les esclaves aient préféré travailler au service de grands propriétaires, puisqu’ils pouvaient dès lors vivre dans des baraquements dédiés, où l’absence de Blancs leur permettait de mener une existence plus tranquille. De plus, les esclaves tiraient une certaine fierté de la richesse de leur maître : « être esclave était déjà assez terrible, écrivait un fugitif, mais être l’esclave d’un homme pauvre était un véritable déshonneur ! »
Les esclaves les mieux lotis étaient sans doute ceux qui vivaient à la ville. C’est en milieu urbain que la relation entre maître et esclave était la plus lâche ; on pouvait trouver là des esclaves qui étaient quasiment libres, et louaient leur propre temps. Les maîtres des villes savaient que si leurs esclaves qualifiés trouvaient du travail, ils ne pouvaient les empêcher de prendre leurs dispositions. Dans de nombreux cas, le fait de se louer soi-même était le premier pas vers son propre rachat. En plus de profiter des attractions ordinaires de la ville, ces esclaves avaient le loisir bien particulier de se mêler à la communauté des Noirs libres, à l’église ou lors de rassemblements. Les esclaves des villes se comportaient avec une certaine assurance : leurs visages n’étaient pas marqués par l’air « affligé » si caractéristique de leurs frères des campagnes.
Il arrivait que l’attitude décontractée des Noirs des villes suscite la critique. De passage à Richmond en 1852, Olmsted remarqua que l’insolence et l’insoumission des esclaves étaient souvent pointées du doigt dans les journaux. Ainsi du New Orleans Crescent 4, qui exprimait une vive inquiétude quant aux libertés et à l’indulgence accordées aux Noirs dans les villes du Sud profond, renforcée par la facilité qu’il y avait à obtenir de faux laissez-passer : « En l’état actuel des choses, un Noir peut se procurer un laissez-passer pour cinquante cents ou un dollar. »
Dans les régions agricoles, ce sont les domestiques des plantations — la mammy, le majordome, la cuisinière, la servante, le cocher — qui étaient le mieux traités. On leur fournissait des tenues de meilleure qualité que celles des autres esclaves, uniformes ou bien vêtements que le maître ou la maîtresse ne portaient plus. Leur nourriture était meilleure, peu différente souvent de celle de leurs maîtres. Ils vivaient dans une partie de la « grande maison » qui leur était réservée, ou dans une cabane à proximité, et dormaient dans des lits, et non sur des paillasses à même le sol. Le travail qu’on attendait d’eux était moins pénible et plus gratifiant que celui des autres esclaves.
Les esclaves de maison disposaient d’avantages sociaux. C’était avant tout à eux que le maître accordait de la confiance et du crédit ; la mammy, quant à elle, servait souvent de confidente à la maîtresse blanche victime de sa solitude et de son isolement. Il n’était pas rare qu’on leur apprenne à lire et écrire, même lorsque cela était contraire à la loi. Les femmes de chambre et valets avaient souvent l’occasion de voyager. Il y avait parmi les esclaves de maison davantage de mulâtres qu’au sein des esclaves ruraux, en raison des liens du sang qui les unissaient parfois au maître.
Mieux traités, souvent plus clairs de peau, et certainement plus proches du siège du pouvoir, les esclaves de maison prenaient tout le monde de haut, sauf les Blancs de « haut rang ». Humains, trop humains sans doute, les domestiques de couleur n’avaient pas peur d’affirmer leur supériorité sur les autres esclaves. Ils considéraient également leur travail comme une forme de privilège familial, transmis de père en fils et de mère en fille.
Les artisans qualifiés — cordonnier, sellier harnacheur, charpentier, forgeron, menuisier, scieur ou natteur — se situaient juste en dessous de la domesticité dans la hiérarchie de la plantation. Choisis pour leur intelligence et leur savoir-faire, les artisans esclaves valaient plus cher que leurs congénères. Ils étaient également mieux traités et moins soumis à l’autorité du maître : « Faire d’un esclave un artisan, disait James H. Hammond, c’est lui donner la moitié de sa liberté. »
Le chef d’équipe (foreman) était vendu à un prix supérieur sur le marché que l’esclave artisan et bénéficiait d’une plus grande estime de la part de son maître. Sélectionné pour son sérieux, son jugement et sa stature physique imposante, le « surveillant » (driver), comme on l’appelait ordinairement, était le bras droit du contremaître (overseer), chargé de la bonne marche des activités sur la plantation. Il avait des responsabilités variées. Le matin, c’était lui qui sonnait la trompe pour appeler les esclaves au travail. Lorsque ceux-ci arrivaient aux champs, il désignait la quantité spécifique de travail que chaque esclave devait accomplir, et s’assurait en fin de journée que ses consignes avaient été respectées. Si les esclaves travaillaient en équipes, et non selon un système de tâches individuelles, il appartenait au surveillant de leur faire garder le rythme, en leur criant dessus ou en faisant claquer son fouet. C’était encore lui qui autorisait les esclaves à faire une pause pour le repas en début d’après-midi et à ranger les outils au crépuscule.
À la tombée de la nuit, le surveillant avait pour tâche de faire régner l’ordre et le calme dans le quartier des esclaves : loin de se limiter à la discipline au travail, son autorité touchait au « comportement général des esclaves », comme le notait un contemporain. De la même manière que dans les champs, tout acte de désobéissance était puni par le fouet. La sévérité des coups assénés par le surveillant dépendait de sa personnalité : tel individu, grisé par le pouvoir ou proche de son maître au point de s’y identifier, n’hésitait pas à frapper fort ; tel autre, qui compatissait avec le sort de ses congénères, dirigeait son fouet de façon à ne faire qu’effleurer le dos nu de l’esclave en faute, lequel simulait alors des hurlements de douleur.
Le surveillant avait d’autres compensations que le seul plaisir, propre à la nature humaine, de pouvoir manifester sa supériorité sur les autres. Il était souvent exempt de travail dans les champs. Il recevait une meilleure ration, qui pouvait inclure une bouteille de rhum par semaine. Il était également mieux vêtu, ce qui lui permettait, du point de vue de certains maîtres, d’imposer le respect aux esclaves sous ses ordres.
Le sort de l’esclave type, quelles que soient sa fonction et sa région de résidence, dépendait en grande partie des formes de contrôle psychologique et juridique qui s’exerçaient sur lui. Les Blancs tenaient leur autorité de Dieu : telle était la leçon inculquée aux esclaves. Contester la toute-puissance du Blanc, c’était s’exposer à la colère divine, et plus immédiatement encore au mécontentement du maître ici-bas. Car la condition de l’esclave était le fruit de la volonté du Créateur ; les catéchismes destinés à l’instruction religieuse des esclaves contenaient fréquemment des passages semblables à celui-ci :
Q : Qui t’a donné un maître et une maîtresse ? R : C’est Dieu qui me les a donnés. Q : Qui a dit que tu devais leur obéir ? R : C’est Dieu qui me l’a dit.
Les Blancs occupaient une même position de supériorité sur le plan juridique. Qu’il soit esclave ou libre, un Noir ne pouvait témoigner contre un Blanc devant quelque tribunal que ce soit. Il encourait une peine sévère s’il s’en prenait à un individu blanc. Dans le Kentucky, en 1860, six des onze délits pour lesquels un esclave pouvait être mis à mort concernaient des actes commis contre des Blancs (même restés à l’état de tentatives), par exemple l’empoisonnement de son maître ou le fait de mettre du verre pilé dans son lait. Il existait dans de nombreuses communautés des décrets qui obligeaient un Noir à céder le passage à une personne blanche, quitte à devoir marcher sur la route.
Pour l’esclave, toutefois, le plus grand handicap juridique, c’était son double statut de personne et de bien meuble. Cette situation particulière n’allait pas sans poser quelques problèmes : « Les esclaves sont non seulement des biens meubles, affirma un juge de Virginie en 1825, mais ils sont aussi des êtres doués de raison, et en cela ont droit à la compassion du tribunal, lorsque celle-ci peut s’exercer sans empiéter sur le droit de propriété. » Mais c’était là le cœur du problème, car souvent les droits de l’esclave allaient à l’encontre du droit de propriété de son maître.
Dans la grande majorité des cas impliquant un conflit de droits, les tribunaux avaient bien évidemment tendance à donner priorité à la propriété. Ainsi, les mariages entre esclaves ne donnaient lieu à aucune procédure juridique, car cela risquait de porter atteinte au droit de propriété du maître. Par conséquent, bien qu’un maître bienveillant pût permettre à un esclave de posséder un lopin de terre ou de signer un contrat, ce dernier pouvait se trouver dans une situation juridique complexe après la mort de son maître, au moment du règlement de la succession.
Nombreuses étaient les lois restrictives visant à maintenir l’ordre parmi les esclaves. La liberté de réunion ne leur était pas accordée, et les esclaves ne pouvaient se rassembler à plus de quatre ou cinq hormis à l’église, lors d’un enterrement ou durant la période de Noël. Les armes à feu leur étaient interdites. Afin qu’ils ne puissent pas communiquer à distance, on ne les autorisait pas à se servir de tambours ou de trompes. Il était interdit de leur vendre des boissons alcoolisées. Ils ne pouvaient quitter la propriété de leur maître sans un laissez-passer ou une autorisation écrite.
Pour faire respecter la loi, chaque comté disposait de sa patrouille montée, une sorte de police qui se rendait sans prévenir dans les quartiers des esclaves afin de s’assurer que régnaient le calme et la discipline, et qu’aucune cabane ne contenait de marchandises volées, ne dissimulait de fugitif ou n’était le théâtre d’une réunion secrète. La participation aux patrouilles était du même ordre que la conscription militaire, une patrouille étant de fait composée d’individus appelés à servir la milice ; de nombreux conscrits préféraient payer une amende plutôt que de participer à ce système extrêmement impopulaire. Dans les villes, des officiers de police s’assuraient qu’il n’y avait plus de Noirs dans les rues après qu’on eut sonné l’heure de leur couvre-feu, en général vers neuf heures en hiver et dix heures en été.
Parmi les nombreuses peines infligées aux esclaves, la plus courante était de loin la flagellation. Au besoin, on envoyait les esclaves récalcitrants ou susceptibles d’user de leur force se faire fouetter par un « briseur d’esclave » rémunéré pour ses services. Un fugitif avait toutes les chances d’être marqué au fer à un endroit visible, de sorte qu’on puisse le reconnaître si jamais il venait à fuir à nouveau. Un esclave rebelle encourait le risque d’être revendu à un planteur d’un État du Sud profond, ce que redoutaient tout particulièrement les populations asservies. Quelques plantations de grande taille disposaient de leur propre prison, mais puisque l’emprisonnement impliquait une perte de temps de travail, on ne l’utilisait pas souvent. La privation de nourriture en guise de punition avait également un inconvénient : elle affaiblissait les esclaves. De même, il était rare qu’on condamne un esclave à la peine de mort, car cela signifiait la perte d’un bien que l’État aurait peut-être à compenser.
Par crainte que ce dispositif punitif ne suffise pas à lui seul à s’assurer l’obéissance des esclaves, certains maîtres mettaient en place un système de récompenses ; ils usaient ainsi de la carotte autant que du bâton. Lorsqu’un esclave avait effectué des heures supplémentaires, travaillé le dimanche ou avec une assiduité supérieure à celle qu’on exigeait de lui, on lui donnait de petites sommes d’argent ou des rations supplémentaires de nourriture. Il arrivait aussi qu’on accorde des jours de congé aux esclaves pour leur redonner le moral : le 4 juillet et le 25 décembre leur étaient systématiquement accordés. Les festivités de Noël, qui souvent duraient jusqu’à une semaine, étaient particulièrement appréciées. Le temps fort en était la matinée de Noël, lorsque les esclaves se rendaient à la grande maison, y étaient accueillis par le maître et la maîtresse, et recevaient de leurs mains divers petits cadeaux ainsi qu’un verre de liqueur. On les autorisait parfois à danser ; en l’absence d’un joueur de violon, on dansait le « patting Juba ». L’une des danses préférées des esclaves était le « Jump Jim Crow » :
Je claque du bout du talon,Pis je claque de la pointe de l’orteil,Et chaqu’fois que j’me tourne,Je danse le Jump Jim Crow.
Reste une question laissée en suspens : comment vivait-on le fait d’être esclave ? Une fois établi que tous les esclaves ne pensaient pas pareil ou ne travaillaient pas dans les mêmes conditions, il faut préciser que les sources d’information sur cette question ne sont guère satisfaisantes. Il n’est pas facile de savoir ce que pensaient les esclaves ; la plupart d’entre eux étaient illettrés et ne tenaient pas de journal. On doit cependant aux esclaves fugitifs un certain nombre d’autobiographies (une centaine), qui forment une branche à part de la littérature américaine, celle des récits d’esclaves fugitifs héroïques. Mais ces récits d’esclaves ont tendance à privilégier des éléments sensationnels : l’émotion y tient une place plus importante que l’analyse. Souvent rédigés par des abolitionnistes au nom de tel ou tel esclave, ils révèlent ce que les réformateurs blancs s’imaginaient des sentiments de l’esclave.
Il faut aussi considérer avec beaucoup de prudence les propos échangés par les esclaves avec la population blanche, qu’on pense au maître, à ses convives, ou à des gens de passage. Un esclave se devait de faire très attention à ce qu’il disait lorsqu’il s’adressait à un Blanc. Souvent il n’avait d’autre choix que d’acquiescer. L’esclave avait appris à discerner dans le ton de la voix de son maître le type de réponse que ce dernier voulait entendre ; peu importait que cette réponse fût vraie ou fausse du moment qu’elle satisfaisait le maître.
Car l’esclave devait toujours jouer un rôle, se comporter de la manière qu’il pensait être la plus conforme à ses intérêts. Dès lors, il avait tendance à flatter servilement, à porter le masque de l’humilité. Il adoptait une attitude enfantine et faisait croire qu’il était attaché à son maître et complètement dépendant de lui. Il allait parfois jusqu’à feindre la stupidité. C’était là un autre aspect de sa stratégie de survie, car son regard apathique lui servait de protection ; il était dangereux d’en savoir trop. Les esclaves jouaient leur rôle avec tant de conviction qu’on peut se demander, avec le professeur Stanley Elkins, s’ils n’avaient pas internalisé leur comportement — si le masque n’était pas devenu l’homme, ou si le stéréotype du Noir docile (celui qu’on appelle le « Sambo ») n’avait pas fait naître un véritable Noir docile.
Assurément, les esclaves devaient s’ajuster à leur situation. Mais cela ne signifie pas qu’ils s’en contentaient. Ils résistèrent de bien des façons, que ce soit en ralentissant la cadence de leur travail ou en fomentant des révoltes de grande ampleur. La « résistance quotidienne », comme on l’a nommée, était l’une des formes les plus courantes de protestation. Un esclave au travail pouvait faire exprès d’être inefficace, et faire semblant d’être trop ignorant pour apprendre, en particulier lorsqu’on lui demandait d’effectuer une nouvelle tâche ou d’utiliser un nouvel outil ; l’esclave jouait au plus bête pour mieux ruser contre son maître.
Les esclaves faisaient peu de cas des biens de leur maître : ils maltraitaient le bétail et endommageaient les outils de la ferme. Ils utilisaient leurs houes avec tant de force qu’il devint nécessaire de fabriquer pour eux des instruments particulièrement lourds et solides. Par mesure de précaution supplémentaire, certains maîtres demandaient à ce que chaque outil fût marqué du nom ou des initiales de l’esclave à qui il était attribué. Même s’il ne parvenait pas à casser sa houe, un esclave pouvait s’en servir pour abîmer la récolte ; il s’excusait de sa maladresse si le surveillant venait à lui faire un reproche. À l’évidence, l’esclave avait de nombreuses raisons de ne pas s’acquitter de ses tâches correctement, mais il était avant tout motivé par le sentiment qu’en se vengeant dans le cadre de son travail, il se vengeait contre son maître.
Le maître craignait tout particulièrement la destruction de ses biens par le feu. Ses revenus de l’année pouvaient partir en fumée si une grange pleine de grain ou de tabac était incendiée. Quoique passible de la peine de mort, l’incendie volontaire était tentant pour l’esclave mécontent de son sort car il demandait peu de préparation et il était difficile d’en retrouver l’auteur. Les compagnies d’assurance incendie étaient parfois réticentes à signer des contrats avec les propriétaires d’esclaves.
Un esclave pouvait encore résister en faisant semblant d’être malade. Dès qu’un esclave se disait souffrant, le maître devenait méfiant. Car ils étaient nombreux, les esclaves qui se rendaient à l’infirmerie en prétextant quelque maladie. Le nombre des esclaves indisposés augmentait nettement lorsque les travaux les plus pénibles devaient être accomplis, et diminuait le dimanche ou pendant les jours de congé, lorsque les esclaves étaient maîtres de leur propre temps. Au cours de son voyage, Olmsted assista à une scène lors de laquelle le contremaître d’une plantation de Louisiane força une esclave à travailler la terre malgré ses gémissements et ses plaintes : « Si on leur passait leurs caprices, expliquait le contremaître, tous les esclaves de la propriété seraient alités. »
Il arrivait parfois qu’un esclave s’estropiât lui-même pour éviter le travail, mais l’automutilation était rare. Le suicide présentait un caractère de vengeance, mais il semble que les esclaves y aient rarement eu recours ; un chercheur spécialiste de l’esclavage dans l’Arkansas, le professeur Orville W. Taylor, n’a identifié qu’un seul cas dans l’histoire de cet État, celui d’un fugitif qui avait été capturé. Un esclave du Tennessee, Isham, avala une grande quantité de laudanum après avoir été amené à la Nouvelle-Orléans et mis en vente sur un marché d’esclaves. En 1853, un esclave du Kentucky qui venait d’être condamné à la pendaison se tua de ses propres mains.
Les histoires et les chansons constituaient l’une des formes d’expression les plus subtiles du mécontentement de la main-d’œuvre servile. Les histoires de l’oncle Remus, dans lesquelles compère Lapin parvenait toujours à se montrer plus malin que compère Renard, étaient très appréciées des esclaves, pour lesquels le lapin était devenu un symbole populaire. La chanson, et tout particulièrement le negro spiritual, leur permettait d’évacuer la tension. Ces chants prirent forme au sein des églises noires, menées par des pasteurs esclaves. Un petit nombre de Blancs assistaient systématiquement aux services afin de garder un œil sur ce qui s’y déroulait, ce qui explique que les sermons et les chants religieux ne pouvaient insister trop lourdement sur les conditions de vie des esclaves ici-bas : de tonalité « mystique », ils évoquaient plutôt le royaume à venir et ses Terres promises ruisselant de lait et de miel. Il s’agissait pour les esclaves d’échapper à un quotidien triste et morne grâce à des chants qui célébraient le paradis.
Les paroles de ces chants spirituels peuvent donner l’impression que les esclaves se résignaient à leur sort, mais nombreux étaient les chanteurs noirs qui y lisaient un double sens. S’il est sans doute abusif d’affirmer que le mot « enfer » était compris par les chanteurs comme une métaphore de l’esclavage, et le mot « paradis » comme une façon de désigner la liberté au Nord, on ne peut nier que les esclaves exprimaient à travers leurs histoires et leurs chansons des choses qu’ils ne pouvaient exprimer autrement. Même un esclave sans la moindre éducation pouvait difficilement ne pas percevoir la double signification de ces paroles :
J’ai droit, nous avons tous droit,J’ai droit à l’arbre de vie.
Quel esclave n’aurait pas immédiatement reconnu son maître sous les traits de Pharaon dans deux des negro spirituals les plus connus, « Descends, Moïse » et « L’armée de Pharaon » ?
Descends, Moïse,Descends en terre d’Égypte,Dis au vieux PharaonDe laisser aller mon peuple.
Oh Marie, sèche tes larmes, berce ton âme,L’armée de Pharaon est sous les flots,Oh Marie, sèche tes larmes.
Un ancien esclave écrivait dans son autobiographie la chose suivante : « En nous entendant chanter à tue-tête “Oh Canaan, doux Canaan / Je pars pour Canaan !”, un observateur avisé aurait pu se douter qu’il n’était pas seulement question d’aspirations célestes. Il s’agissait pour nous de rejoindre le Nord : le Nord était notre Canaan. » Quel que soit le paradis, terrestre ou céleste, évoqué dans ces chants, ils permettaient aux esclaves de verbaliser le ressentiment lié à leur condition.
Les esclaves les plus intrépides résistaient à l’institution esclavagiste par la fuite, que ce soit au Mexique, au Canada, dans les États du Nord ou simplement vers la ville la plus proche (Memphis, par exemple, qui attirait les fugitifs d’Arkansas, du Tennessee et du Mississippi). Les motivations de la fuite variaient d’un esclave à l’autre : certains esclaves fuyaient afin de ne plus avoir à travailler, d’autres parce qu’ils craignaient d’être mis aux enchères ou parce qu’ils espéraient retrouver un de leurs proches qui avait été vendu auparavant. Mais dans la grande majorité des cas, le motif le plus impérieux, c’était le dégoût de la vie d’esclave. Il y avait deux manières de fuir : de façon individuelle, ou bien grâce au mouvement collectif connu sous le nom de Chemin de fer clandestin (Underground Railroad) 5.
Nombreux étaient les esclaves qui fuyaient seuls et sans assistance. Ceux qui avaient contourné la loi pour apprendre à lire et à écrire contrefaisaient des laissez-passer et des certificats attestant leur liberté. D’autres, qui n’avaient que l’étoile du Nord pour se repérer, s’enfonçaient dans la forêt : ils se déplaçaient la nuit et se cachaient le jour dans les marais derrière un lit de feuilles. Ils vivaient de ce que la terre leur donnait et se nourrissaient de fruits, de noix, de baies, parfois d’un poulet volé ou égaré. Parmi les milliers d’esclaves qui s’enfuirent par voie d’eau, ceux qui se situaient à proximité du fleuve Ohio utilisaient souvent de petites embarcations individuelles ou des canoës qu’ils avaient volés. Dans les ports des villes du Sud, les esclaves fugitifs avaient recours à des ruses diverses pour s’embarquer sur des bateaux à vapeur à destination des États du Nord. Une astuce courante consistait à s’emparer d’un paquet de linge et à faire semblant d’être un domestique pour monter à bord et se cacher dans la cale. Les compagnies maritimes étaient tenues responsables si un fugitif était découvert à bord d’un bateau, mais cela n’empêchait pas certains capitaines et marins bienveillants de fermer les yeux lorsqu’ils croisaient des passagers clandestins noirs.
L’une des fuites les plus spectaculaires en la matière fut sans doute celle de William et Ellen Craft, originaires de Macon, dans l’État de Géorgie. Comme d’autres avant eux, les deux esclaves se déguisèrent, tout en faisant preuve d’une inventivité singulière. Grâce à l’argent que William avait épargné en louant son temps comme ébéniste, ils purent acheter des vêtements d’homme pour Ellen, quarteronne à la peau claire qui joua le rôle de propriétaire d’esclave. Celle-ci fit semblant d’être dure d’oreille de façon à ce que personne ne cherche à lui faire la conversation, et enveloppa son bras dans un cataplasme afin qu’on ne lui demande pas de signer de registre dans les hôtels et bateaux à vapeur (elle ne savait ni lire ni écrire) ; elle fut particulièrement convaincante dans le rôle du planteur souffrant qui se rendait au Nord pour se faire soigner. William s’en sortit bien également, même s’il était plus facile de jouer le rôle de l’esclave du planteur « invalide ». Le couple voyagea cinq jours durant à travers les États esclavagistes, toujours en première classe, comme l’aurait fait un planteur accompagné de son esclave. Enfin le supplice prit fin lorsque leur train quitta la gare de Baltimore.
Tout aussi insolite fut la fuite de Henry Brown, esclave originaire de Richmond, en Virginie. Ne manquant ni d’audace ni de ressource, Brown fit fabriquer une boîte spécialement conçue et équipée pour sa fuite vers le Nord. Longue d’un mètre et large de soixante centimètres, la boîte arriva jusqu’à Philadelphie par l’Adams Express, après vingt-six heures de transport ; elle contenait de la nourriture et de l’eau, et portait un tampon qui indiquait dans quel sens il fallait la tenir. Une fois la boîte livrée, les quatre hommes qui attendaient impatiemment son arrivée ouvrirent le couvercle à l’aide d’un pied-de-biche. Alors eut lieu ce que William Still, témoin de la scène, appela la « merveilleuse résurrection » de Brown. « Il se releva dans sa boîte, tendit la main, et dit : “Comment allez-vous, messieurs ?” »
Étant donné le danger que représentait cette course folle vers la liberté, la plupart des fugitifs avaient besoin d’aide. Cette assistance, ils la trouvaient dans le Chemin de fer clandestin, un système qui permettait d’accueillir, de cacher et de guider les esclaves en fuite. On appelait « chemin de fer » le réseau de « gares » reliées informellement entre elles, situées à une journée de marche l’une de l’autre, et auxquelles un esclave pouvait être conduit par un « chef de train ». Le premier contact avec les esclaves était mené par un agent de terrain qui se présentait à eux comme marchand ambulant, recenseur ou cartographe. L’agent devait faire preuve d’une certaine habileté pour convaincre un Noir méfiant de ses bonnes intentions, mais une fois sa confiance acquise, ce dernier était rapidement confié à un autre « chef de train », qui le conduisait à la première gare. Nourri, reposé et parfois revêtu d’un déguisement, l’esclave était prêt pour le reste du voyage. L’expédition se faisait de nuit ; durant la journée, l’esclave se cachait dans une grange, une cave, une voilerie ou une meule de foin. Il arrivait qu’un fugitif fût embarqué dans un bateau ou un train, si le commandant de bord ou l’agent des chemins de fer étaient membres du dispositif clandestin, ou tout au moins des personnes dignes de confiance. Le nombre total d’esclaves à qui fut accordée une telle assistance semble avoir été modeste, sans doute aux alentours de 2 500 par an entre 1830 et 1860.
Il n’est pas surprenant que le Chemin de fer clandestin se soit développé dans des États tels que l’Ohio, proches à la fois des régions esclavagistes et du Canada. Toutefois, même le Connecticut, situé largement au nord de la ligne Mason-Dixon 6, disposait d’un réseau relativement étendu. Le révérend Simeon S. Jocelyn, fondateur d’une église pour gens de couleur, l’église de Temple Street, et Amos G. Beman, premier pasteur noir de l’église, faisaient partie des agents de New Haven. Farmington, que traversait la route principale vers le Massachussetts, était la ville la plus prospère de l’État ; tout fugitif qui atteignait Farmington, écrit Horatio T. Strother, était assuré d’obtenir de la nourriture, un hébergement et un moyen de transport.
La vie de Calvin Fairbanks permet de comprendre le danger et la menace qui planaient en permanence sur un « chef de train » dont « la ronde » se situait en territoire esclavagiste. En 1844, Calvin Fairbanks se rendit à Lexington, dans le Kentucky, avec la ferme résolution d’aider des esclaves à rejoindre l’Ohio, où ils seraient confiés à Levi Coffin, un quaker dont le zèle à l’égard des fugitifs noirs lui valut le titre de « président du Chemin de fer clandestin ». En février 1845, Fairbanks fut condamné à quinze ans d’emprisonnement pour avoir assisté (avec succès) trois fugitifs, parmi lesquels Lewis Hayden, qui devint plus tard membre de la législature du Massachussetts. Après quatre années passées en prison, Fairbanks fut gracié à condition qu’il quittât le Kentucky. Fairbanks n’en fit rien et poursuivit son travail, qui consistait selon ses propres termes à « libérer des esclaves de l’enfer ». Arrêté de nouveau, il fut condamné en 1852 à quinze ans de travaux forcés au pénitencier de l’État. Il resta enchaîné dans une étroite cellule jusqu’en 1864, date à laquelle il fut gracié. Sa participation au Chemin de fer clandestin lui valut en définitive de passer dix-sept ans et quatre mois derrière les barreaux.
De constitution frêle mais d’une volonté de fer, Harriet Tubman fut la plus célèbre des conductrices du Chemin de fer clandestin. Née dans le comté de Dorchester, dans le Maryland, et elle-même fugitive, Harriet se rendit dix-neuf fois dans les États esclavagistes et conduisit plus de trois cents Noirs vers le Nord ou le Canada. Il était impossible de faire marche arrière une fois qu’on avait rejoint l’équipe de sauvetage de Tubman, car celle-ci menaçait de mort quiconque tentait de changer d’avis ; elle n’eut jamais à mettre cette menace à exécution. Tubman ne connut pas les déboires de Fairbanks : elle vécut une existence miraculeuse, et servit également comme espionne, éclaireuse et infirmière durant la guerre de Sécession sans jamais se faire prendre.
Non seulement les opérations du Chemin de fer clandestin privaient les maîtres d’une partie non négligeable de leur patrimoine, mais elles encourageaient aussi les esclaves les plus téméraires à fuir, lesquels laissaient derrière eux moins d’esprits audacieux susceptibles de prendre part à une révolte armée, dernier recours des esclaves contre leur oppresseur. De tels soulèvements avaient très peu de chance de réussir, ce dont devaient être conscients leurs instigateurs. Mais ceux-ci étaient sous l’emprise d’une obsession personnelle ; ils ne pouvaient pas se résigner à finir leur vie comme esclave. En dépit des très faibles chances de conquérir leur liberté par la lutte armée, ils étaient déterminés à prendre des risques, parce qu’ils ne pouvaient pas se résoudre au sort atroce que l’on nommait l’esclavage.
Herbert Aptheker a rassemblé des archives ayant trait à quelque deux cent cinquante conspirations et révoltes d’esclaves, certaines datant de l’époque coloniale. En 1712, puis en 1741, New York fut le théâtre de soulèvements durant lesquels un total de treize Blancs et cinquante Noirs au total perdirent la vie. La révolte la plus importante de la jeune Amérique eut lieu en 1739 à Stono, en Caroline du Sud, et causa la mort de soixante-cinq personnes.
Parfois une révolte était encouragée par la connaissance qu’avaient les esclaves de soulèvements révolutionnaires ayant eu lieu ailleurs, dont le plus important fut celui mené par Toussaint L’Ouverture à Saint-Domingue. Au début des années 1790, les esclaves maltraités prirent leur destin entre leurs mains et des milliers de maîtres fuirent à Cuba et dans les villes portuaires du Sud, à la Nouvelle-Orléans, Savannah, Charleston et Baltimore. En fin de compte, la France dut renoncer à son intention de reconquérir l’île, renommée Haïti par le successeur de Toussaint, Dessalines. L’émergence d’une nouvelle nation, née d’une révolte et gouvernée par les Noirs, donna du courage aux esclaves des États-Unis.
Tandis que les Noirs conduits par Toussaint gagnaient leur indépendance, l’esclave Gabriel du comté de Henrico, en Virginie, tentait d’organiser un semblable soulèvement. Durant l’été 1800, il rassembla quelque 1 000 esclaves, les arma de gourdins, de couteaux et d’armes à feux, et marcha vers Richmond, qui se trouvait à une dizaine de kilomètres. Il n’y parvint jamais. Des pluies plus fortes qu’à l’accoutumée avaient inondé les routes et les ponts, ce qui rendait le passage impossible. De plus, les autorités de Richmond se tenaient à l’affût, car le complot avait été divulgué par deux esclaves. Non seulement Gabriel et une trentaine de ses partisans furent pendus, mais le gouverneur James Monroe prit une mesure dissuasive supplémentaire, celle d’établir une garnison militaire dans la ville.
Une autre conspiration gravée dans les mémoires eut lieu à Charleston, en Caroline du Sud, en 1822. Son initiateur fut le Noir libre Denmark Vesey, qui avait longuement réfléchi à la situation désespérée des esclaves, et s’était intéressé à l’histoire des révolutions française et américaine, aux soulèvements à Saint-Domingue, ainsi qu’aux vifs débats entre les membres du Congrès sur l’admission du Missouri dans l’Union en tant qu’État esclavagiste. Une fois leur plan d’attaque élaboré, Vesey et ses fidèles constituèrent une réserve de poignards, de fers d’épieux, et de baïonnettes, qu’ils devaient dans un premier temps compléter grâce à un raid sur les deux arsenaux de la ville. Il était prévu que la révolte commençât un dimanche soir de juillet, lorsqu’un grand nombre de Blancs seraient en villégiature. Mais avant que les conspirateurs aient pu frapper, le complot fut révélé par un esclave devenu informateur. Lors des procès qui suivirent, trente-cinq des conspirateurs, dont Vesey, furent condamnés à la pendaison.
Aucune révolte n’eut autant de répercussions que celle menée par Nat Turner. Turner, esclave prédicateur du comté de Southampton, en Virginie, fut guidé dans ses actions par son interprétation de l’Ancien Testament et sa conviction qu’il était l’oint du Seigneur, destiné à conduire les esclaves hors du royaume de la servitude. Plutôt que de se préparer en recrutant un grand nombre de partisans, Turner se tourna vers la prière et l’attente d’un signe en provenance du ciel. Aussi, lorsqu’il entama sa croisade un soir d’août 1831, son équipe ne comptait pas plus de huit membres. Ils commencèrent par tuer le maître de Nat et sa famille. Au fur et à mesure de leur progression à travers la campagne, ils furent rejoints par de nouvelles recrues et se retrouvèrent au nombre de soixante-dix. Pris par surprise dans leurs maisons grandes ouvertes en raison de la chaleur, près de soixante Blancs furent capturés et mis à mort. La rébellion prit fin quarante-huit heures plus tard, après que les Blancs tirés de leur sommeil eurent mobilisé des troupes de volontaires et fait appel à la milice. « Le Prophète », ainsi que le surnommaient les esclaves, fut capturé et envoyé à la potence avec dix-neuf autres coupables.
Le Sud d’avant la guerre de Sécession n’oublia jamais Nat Turner. Il n’y eut ensuite plus aucune autre révolte importante de Noirs, mais à partir de ce jour d’août 1831, les États esclavagistes furent constamment en proie à des rumeurs de soulèvements. Cette inquiétude conduisait parfois à l’hystérie collective, qui ne diminuait qu’après la capture, le jugement et la condamnation d’un certain nombre de Noirs. Les habitants du Sud pouvaient toujours prétendre que leurs esclaves étaient comblés et dociles, et qu’il n’y avait par conséquent rien à craindre d’eux. Mais Nat Turner lui-même avait donné l’impression d’être docile et comblé ; dès lors, il était toujours possible qu’un esclave apparemment satisfait de son sort cachât en réalité un autre fauteur de trouble.
Pour empêcher une tragédie semblable à celle du comté de Southampton, les États esclavagistes renforcèrent leurs patrouilles et défenses militaires, adoptèrent des codes noirs plus rigoureux, resserrèrent leurs rangs, et n’autorisèrent aucune critique de l’institution esclavagiste en leur sein. Ils réaffirmèrent également leur domination sur une partie de la population dont ils estimaient qu’elle était presque aussi dangereuse que les esclaves rebelles : les Noirs libres 7.