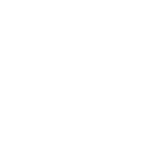L’imaginaire peut être défini sommairement comme le fruit de l’imagination d’un individu, d’un groupe ou d’une société, produisant des images, des représentations, des récits ou des mythes plus ou moins détachés de ce qu’il est d’usage de définir comme la réalité.
Cet article propose une réflexion sur les imaginaires ambivalents qui traversent la question de l’habitat temporaire et de ses habitants. Qu’est-ce que j’entends par imaginaire ambivalent ? Discréditée par ses usages en termes d’archétypes premiers, disqualifiée par l’anthropologie structurale qui postulait le primat du symbolique, la notion d’imaginaire est complexe à manier, voire dangereuse — académiquement s’entend. À la suite des travaux de Cornelius Castoriadis, de Benedict Anderson et de Arjun Appadurai, elle me paraît toutefois la plus pertinente pour désigner la résultante d’une combinaison de récits, d’images, de savoirs, d’expériences, de discours politiques, artistiques ou scientifiques ; de slogans, de points de vue experts et de sens commun portés sur des personnes perçues comme non sédentaires, et leurs habitations précaires. Si le concept d’imaginaire national développé par Benedict Anderson a fait florès, Arjun Appadurai 2 lui oppose un imaginaire global lié aux flux culturels transnationaux (ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, finanscapes, ideoscapes). Après Gaston Bachelard et Benedict Anderson, Arjun Appadurai distingue notamment image, imaginaire, imaginé et imagination. Il considère que la friction entre les images, les imaginaires et les communautés imaginées permet l’émergence de l’imagination comme pratique sociale et la coproduction de « localités » globales, susceptibles de s’autonomiser vis-à-vis des relations de voisinage traditionnelles. C’est cette hypothèse qui guidera notre réflexion.
Malgré la diversité et la complexité des objets et des discours sur le « non permanent - non sédentaire », il y a quelque chose de commun dans ce qui circule dans Wikipédia ou sur les réseaux sociaux, dans les musées et les bibliothèques, au sein des comités de soutien, des conférences de presse ou des colloques scientifiques, dans les catalogues et les projets d’architecture, dans la presse ou à la télévision, dans nos conversations, au café du commerce ou dans les associations humanitaires. Pour tenter de cerner ce « quelque chose de commun », j’ai retenu, presque au vol, quelques unes des notions qui circulent au sujet du « temporaire » : les nomades, les voyageurs, les Roms et les pendulaires ; la bohème, la création, la marginalité et la transgression ; le squat, le camp, le campement, la friche, le bidonville, la cabane et l’autoconstruction ; la récup’, la débrouille et le recyclage ; le localisme et le cosmopolitisme, l’errance et la mobilité. Il ne s’agit surtout pas de proposer des archétypes, mais de s’intéresser à ces notions en tant que constructions sociales et politiques caractérisées par leur ambivalence. Terme médical à l’origine, l’ambivalence désigne un caractère qui comporte deux composantes opposées, la simultanéité de deux sentiments ou de deux comportements opposés vis-à-vis d’une personne ou d’une situation : désir et dégoût, envie et rejet, amour et haine.
Par delà les discours et les valeurs promues par les protagonistes que nous allons étudier, l’ambivalence des imaginaires du temporaire a également un caractère pratique et politique. Or, pour le décrire et le déplier, il faut s’accrocher quelque part. Je prendrai donc pour appui principal, mais non exclusif, les observations que j’ai pu réaliser ces dernières années dans quelques friches, squats et bidonvilles de la ville de Saint-Denis, avec leurs habitants, résidents, voisins, passants, etc. L’intérêt de ce camp de base pour l’élaboration de ma réflexion vient de la proximité physique de personnes aux propriétés sociales très éloignées. Mais ce texte se nourrit également d’une triple observation flottante, ou militante, moins localisée : sur la condition et le traitement des populations dites roms, sur l’habitat temporaire, notamment de loisir, et sur les processus de métropolisation dans le Nord-Est parisien.
Sur la forme du texte et son caractère expérimental. L’ambition d’un texte ethnographique est de restituer quelque chose de l’expérience que l’auteur veut donner à comprendre, ici le caractère ambivalent et multiforme des références qui autorisent des gens, pour qui l’éphémère est une valeur, à se sentir proches d’autres personnes, pour qui le précaire est une réalité. D’une manière plus théorique, mon travail de recherche porte sur la circulation et l’hybridation des savoirs, des images et des récits, et cet article s’inscrit aussi dans cette perspective. Dans cette double optique, il s’agit de connecter des travaux, des savoirs et des images généralement dissociés, en articulant un texte synthétique et ses extensions multi-thématiques, afin de restituer, de manière presque analogique, le bricolage conceptuel qui fait coexister le nomade, le vagabond, le tsigane, et l’artiste, la bohème, le bidonville et la Cour des Miracles, le bricoleur locavore et recycleur, le dangereux apatride, le migrant inintégrable et le citoyen européen et cosmopolite.
S’accrocher quelque part :
Saint-Denis
Confluence, feuilleté de friches
Situé à l’ouest de la gare de Saint-Denis, entre la Seine, le canal et leurs alentours, le quartier de la gare, rebaptisé Confluence, a fait l’objet de très nombreux bouleversements ces dix dernières années : destruction d’une grande partie de l’habitat, souvent insalubre, reconfiguration de la gare, prolongement d’un tramway et installation d’un autre, création d’une place. Dans ce contexte de bouleversement urbain et sociologique, au milieu des immeubles désaffectés, puis des terrains vagues, un ancien immeuble de bureaux de 3200 m², exemple d’architecture « brutaliste », est devenu en 2010 une friche culturelle, une résidence d’artistes : le 6B 3. Propriété du groupe immobilier Brémond 4 et géré par une association, il regroupe aujourd’hui 140 ateliers dont la grande majorité des locataires vit à Paris : artistes plasticiens, architectes ou créatifs, sièges sociaux de plusieurs compagnies de danse ou de théâtre, espaces d’exposition. Au cours des étés 2011 et 2012, les abords du 6B s’animent grâce à la Fabrique à Rêves 5, un festival à la programmation éclectique, avec DJs, terrain de beach-volley, et concerts « pointus », qui fait venir de nombreux Parisiens. Pendant l’hiver 2013, l’association 75021 6, organise des after électroniques qui accueillent près d’un millier de participants dans les locaux du 6B. L’été 2013, les grues ont avancé. Réduite à quelques soirées, la Fabrique à Rêves s’est exportée dans d’autres quartiers. L’immeuble reste seul sur cet immense terrain vague, seul avec le petit bureau de vente des appartements qui vont bientôt sortir de terre. À l’été 2015, le nouveau quartier est presque terminé, même s’il n’a pas d’école et que tous les habitants ne sont pas encore installés. Après la réussite de sa collaboration avec l’architecte Patrick Bouchain à Nantes, le groupe Brémond travaille à Saint-Denis avec l’un de ses disciples, Julien Beller, initiateur et mentor du 6B. Il ne s’agit pas ici de laisser le jeune architecte concevoir les bâtiments, mais de s’appuyer sur la présence des « créatifs » pour donner de la plus-value à un projet immobilier. Julien Beller assume en revendiquant son rôle de « défricheur » et « d’avant-garde de la capitale et du capital 7 ». A priori un processus classique de gentrification, avec exclusion des plus pauvres vers des banlieues toujours plus lointaines. Nous allons le voir, les choses sont plus complexes. Uniquement séparée du 6B par le canal et un premier bidonville écrasé en 2012, puis un second réinstallé en 2013, la Briche 8 est une ancienne entreprise de recyclage des métaux — un ferrailleur. Constituée de pavillons, de vastes hangars et d’un brise-fonte, propriété de l’héritière de l’usine, la Briche est louée à une cinquantaine d’artistes, et d’artisans qui travaillent dans les arts appliqués, le cirque ou la fabrication de décor. Cette petite communauté a été initiée par Nicolas Cesbron, sculpteur, qui y a construit une maison de bois qu’il partage avec Jean-Matthieu Fourt, comédien et co-animateur, notamment, du café culturel de Saint-Denis 9. En mai 2013, c’est « la Briche foraine », un week-end de fête et d’ouverture des ateliers est organisé en relation avec une exposition d’artistes dionysiens et la fête du quartier, afin d’attirer les riverains 10. Des centaines de familles dionysiennes, et de nombreux Parisiens venus pour l’occasion découvrent ainsi les ateliers des « Brichoux », goûtent les performances circassiennes ou la « soupe rom » mijotée sous le brise-fonte. Les Brichoux remettent cela en mai 2014 11. Anarchistes felliniens, militants de l’éducation populaire ou jeunes diplômés de l’école Boule prônant l’autogestion, les habitants de la Briche partagent un esprit communautaire, la revendication d’un ancrage local et un discours de la résistance face une gentrification, dont ils se savent pourtant partie prenante. L’avenir de la Briche est incertain, mais, contrairement aux résidents du 6B, la plupart des Brichoux ne revendique pas une installation pérenne, imaginant déjà reconstituer ailleurs la communauté.En juillet 2015, la Briche foraine se délocalise sous l’autoroute, Porte de Paris, au cœur du nœud autoroutier de l’A1 et de l’A86 12. Elle confirme l’inscription des Brichoux dans le monde du cirque et du spectacle de rue 13. La Briche foraine attire désormais des milliers de Parisiens. Les commentaires des locaux oscillent entre amusement et agacement : par exemple, on reconnaît le Parisien parce qu’il fait la queue, très longtemps, pour acheter un vin nature et un hamburger bio dans une cabane arty, alors que le Dionysien préfère se concentrer sur le tas de grillades Lidl cramées sur des barbecues bricolés par les voisins des Brichoux, fournisseurs habituels.
Voisinage et localités
Alors, l’avant-garde de la connerie c’est nous ! Les bobos, les artistes sont en avant-garde de la connerie humaine. Là, ça va être pareil que d’habitude, mais on va essayer que cela se passe moins mal que d’habitude. Paris, c’est la banlieue de Saint-Denis. La force va être ici. Ici c’est l’avant-garde de la connerie humaine comme Saint-Germain ou Montmartre autrefois. La Bohème, c’était la connexion entre pauvres et riches, même physiquement.
Icône parisienne de la friche artistique dite « métropolitaine », le 6B peut être analysé comme le moteur d’un double mouvement d’inclusion de la banlieue dans les imaginaires de la critique artiste, et d’exclusion de ses populations dans ses suites immobilières. Pour le groupe immobilier propriétaire, et la plupart de ses locataires, il s’agit bien de transformer l’espace et sa population, de faire grandir Paris, sans autre revendication politique apparente que celui de constituer une avant-garde artistique et urbanistique. À l’inverse, la Briche se revendique contre-culture, contre-ville, anti-métropole créative :
Paris c’est la banlieue de Saint-Denis. La force va être ici.
Ses habitants affirment s’intégrer localement, rendre concrète l’utopie d’une rencontre multiculturelle, en « testant tous les rades, tous les restos, tous les quartiers ». Pourtant, leurs initiateurs et mentors, se retrouvent dans la volonté, en pratique et en discours, de nouer des relations avec les bidonvilles environnants. Après une première expérience dans le quartier du Hanul 15, dans le cadre de son diplôme d’architecture, et de plusieurs projets sur l’architecture éphémère, Julien Beller est devenu le « spécialiste » de l’installation des toilettes sèches dans les bidonvilles d’Île-de-France, les friches ou les festivals culturels. Alors qu’il est à Saint-Denis taxé de « bobo » comme il le dit lui-même, son action ne reflète pas les positions des résidents du 6B, parfois indisposés par le caractère trop « populaire » de ses fêtes et de son activisme. Entre 2010 et 2013, la Briche et le 6B étaient séparés par le canal et un petit bidonville dit « de la vieille mer ». De juillet 2014 à août 2015, un autre bidonville s’est installé à quelques dizaines de mètres, contre la voie ferrée. D’autres, situés à quelques centaines de mètres, ont été expulsés et se réinstallent un peu plus loin, un peu plus près, au gré des travaux et des terrains disponibles. À chaque fois, on observe des échanges entre notre communauté d’artistes et artisans bohèmes (les Brichoux), notre « lab » d’architectes d’avant-garde (le 6B), et d’éphémères bidonvilles habités par des immigrés d’Europe centrale, ballottés d’une expulsion à l’autre. Si les interactions et les intrications concrètes entre les friches et les bidonvilles semblent initialement déclenchées par la proximité spatiale, ce voisinage, in fine, n’explique rien : en Seine-Saint-Denis, des centaines de milliers de gens vivent à proximité des bidonvilles, sans jamais y pénétrer ni interagir avec leurs habitants. Comment s’opère la rencontre ? Mon hypothèse est qu’elle est le fruit de l’imaginaire social 16 des mentors du 6B et de la Briche, et de leurs semblables. Un imaginaire qui donne une signification particulière, sociale et contextuelle aux lieux interstitiels, aux friches, à la ferraille, aux squats, à la récup’, à l’autoconstruction, à la débrouille ou au monde forain. Ou encore, la manière dont l’imagination et le travail d’architectes et d’artistes se nourrissent des références, des images et des récits venus de tous ces mondes. Résidents du 6B et habitants de la Briche se rejoignent aussi dans un choix plus assumé, la volonté de renverser le stigmate associé aux populations dites roms qui peuplent les interstices du territoire de Plaine-Commune 17. Ils s’avèrent d’actifs soutiens avec les collectifs de voisins qui surgissent, souvent en vain, pour stopper les expulsions à répétition. Pour le dire de manière « objectivée », même si les motivations et les modalités de la solidarité s’avèrent différentes, les imaginaires bourgeois de l’avant-garde et ceux de la bohème se retrouvent dans le récit d’une proximité avec ces populations marginalisées, souvent présentées comme nomades (ce qu’elles ne sont pas), imaginatives, transgressives. En quelque sorte, les Roms, comme les voyageurs, incarnent la possibilité d’une hétérotopie, le fantasme deleuzien du nomade rhizomique chers aux architectes et aux artistes, mais non aux pouvoirs sédentaires. À l’inverse, les résidents des friches expriment une certaine aversion pour le bâti et le mode de vie des classes sociales intermédiaires, « la ville des classes moyennes » que l’agglomération de Plaine-Commune et les promoteurs immobiliers construisent à grande vitesse sur le territoire, contre eux, mais grâce à eux. Au regard de ces observations, je propose de prendre au sérieux les pratiques, les discours et les valeurs de ces artistes et de ces architectes habituellement catalogués de bobos, bourgeois bohèmes donc, dès lors qu’ils osent se dire proches des habitants des différents bidonvilles qui les ont entourés, les entourent et les entoureront. Quoique critique, mon analyse ne vise pas à moquer ces projections, mais à tenter ici de remonter le fil conducteur et connecteur, le passage de l’imaginaire de la bohème mobile à celui du locavore, tout en m’attachant à la question de l’habiter temporaire.
Bohémiens, Bohème, l’art
et la fête
Je me suis pâmé, il y a huit jours, devant un campement de Bohémiens qui s’étaient établis à Rouen. Voilà la troisième fois que j’en vois. Et toujours avec un nouveau plaisir. L’admirable, c’est qu’ils excitaient la haine des bourgeois, bien qu’inoffensifs comme des moutons. Je me suis fait très mal voir de la foule, en leur donnant quelques sols. Et j’ai entendu de jolis mots à la Prudhomme. Cette haine-là tient à quelque chose de très profond et de complexe. On la retrouve chez tous les gens d’ordre. C’est la haine qu’on porte au Bédouin, à l’Hérétique, au Philosophe, au Solitaire, au Poète. Et il y a de la peur dans cette haine. Moi qui suis toujours pour les minorités, elle m’exaspère. Du jour où je ne serai plus indigné, je tomberai à plat, comme une poupée à qui on retire son bâton.
Ce mot de Bohème vous dit tout. La Bohème n’a rien et vit de tout ce qu’elle a. L’espérance est sa religion, la foi en soi-même est son code, la charité passe pour être son budget. Tous ces jeunes gens sont plus grands que leur malheur, au-dessous de la fortune, mais au-dessus du destin.
De la proximité aristocratique à la fascination-répulsion bourgeoise
Les travaux d’Henriette Asséo 20 attestent de la proximité, à différentes époques, des aristocraties européennes et des Bohémiens. Les tsiganes arrivent aux portes de Paris au début du XVe siècle, et suscitent d’emblée des réactions ambivalentes, entre curiosité, fascination et scandale. C’est par exemple ce que nous explique une guide conférencière du Grand Palais dans un visite virtuelle de l’exposition 21, à propos des diseuses de bonne aventure :
En 1427, les Bohémiennes ont cocufié tout Paris.
Les stéréotypes du petit voleur, de la cartomancienne et du peuple venu d’Égypte se diffusent à travers les représentations qu’en font les peintres européens, dont Léonard de Vinci 22, Georges de La Tour 23, ou Caravage 24. Dans le même temps, auprès des cours d’Europe comme dans les villages, ils sont considérés comme d’utiles relais d’informations, pourvoient à la distraction et aux spectacles, mais sont aussi des mercenaires utiles pour les seigneurs de Province. Ils bénéficient en retour de protections et de laissez-passer. Cette proximité ne leur est pas toujours bénéfique, tant s’en faut. Ainsi, pour lutter contre la noblesse frondeuse, Louis XIV met au ban les bohémiens, envoie les hommes aux galères, expulse les femmes et les enfants. La suite française n’est qu’une succession de lois visant à empêcher l’itinérance — sans l’interdire toutefois, et, surtout, à réprimer des populations de plus marginalisées 25. Aristocrates et Bohémiens se fréquentaient dans des liens de dépendance et d’altérité radicale, la bourgeoisie va les considérer comme un risque et un scandale, avant que le romantisme s’en inspire et n’en produise une image idéalisée et détachée de tout contact réel, ou presque. C’est la Bohème. Sans doute inventé au milieu du XVIIe 26, le terme ne va véritablement se généraliser qu’à partir de 1830, avec l’émergence d’un romantisme épris d’orientalisme, alors que la France est en pleine conquête coloniale. Un opéra de Puccini, La Bohème 27, deux ouvrages, Un prince de la Bohème de Balzac 28, et Scènes de la vie de Bohême (sic) de Henri Murger 29 — paru en feuilleton dans les années 1840, et largement autobiographique — font entrer l’expression et sa signification dans le langage courant. Si les uns inspirent l’autre, la Bohème va donc se faire sans les bohémiens, à travers les images et les imaginaires. La Bohème désigne d’abord un choix de vie : la création à tout prix, la solidarité, la pauvreté, l’insouciance, les hôtels garnis des quartiers populaires, la rupture avec les conventions, l’ennui et l’ordre social bourgeois. Le bohémien, et surtout la bohémienne, deviennent en revanche un thème artistique récurrent, un sujet de peinture, une sorte de figure exotique de l’intérieur, présente aussi bien dans la musique que la littérature ou la peinture du XIXe 30. Les rencontres se font furtives, et rares, mais elles existent. Mais il s’agit encore, à l’instar de Flaubert de « choquer le bourgeois ». Il y a donc, en Europe de l’Ouest, une première rencontre, physique, entre bohémiens et aristocrates, puis dans une deuxième période, une connexion à travers les images ou les imaginaires : les Bohémiens ne sont plus des personnes sollicitées pour une fête, mais les personnages de créations musicales, picturales, littéraires. La vie nomade des bohémiens n’est, elle, pas encore exotique : elle est le lot commun d’une grande partie des travailleurs, alors que près de la moitié des commerces parisiens sont itinérants au milieu du XIXe 31. En Île-de-France, les bohémiens vivent notamment dans « la zone » située derrière les fortifications de Paris, avec le petit monde des biffins, et tous ceux que Karl Marx va identifier comme un « lupen prolétariat » objectivement allié des puissants, cette masse errante, fluctuante et allant de ci-de là que les Français appellent “la bohème”
.
Louis-Napoléon avait formé (sous la façade d’une “société de bienfaisance”) une force d’intervention qui lui était dévouée avec des roués ruinés n’ayant ni ressources ni origine connues... [...] les rebuts et laissés pour compte de toutes les classes sociales, vagabonds, soldats renvoyés de l’armée, échappés des casernes et des bagnes, escrocs, voleurs à la roulotte 32, saltimbanques, escamoteurs et pickpockets, joueurs, maquereaux, patrons de bordels, portefaix, écrivassiers, joueurs d’orgue de barbarie, chiffonniers, soulographes sordides, rémouleurs, rétameurs, mendiants, en un mot toute cette masse errante, fluctuante et allant de ci-de là que les Français appellent “la bohème”.
De quelle bohème Marx parle-t-il ? Des bohémiens errant ou de la Bohème romantique des Français ? S’agit-il d’une faute d’accent, d’un contre-sens ? Quoi qu’il en soit, cette ambiguïté est peut-être fondatrice de l’ambivalence qui nous intéresse.
Bourgeois et bohème :
proximités contemporaines
Aujourd’hui, la bohème est une chanson d’Aznavour 34, un souvenir touristifié. Le bourgeois bohème n’est plus l’artiste pauvre et prometteur consacré par le romantisme du XIXe. Le bourgeois bohème, c’est le « bobo », terme inventé en 2000 par le journaliste américain David Brooks pour qualifier la nouvelle élite américaine d’alors : éduquée, informée, hybridée, avec un pied dans le monde bohémien de la créativité, et l’autre dans celui du réalisme bourgeois de l’ambition et du succès
35. Le « bobo » est désormais un terme générique, plutôt dépréciatif, désignant toute personne qui se distingue à la fois des catégories populaires par ses revenus, des classes moyennes par son attitude dite d’avant-garde, et des classes supérieures par ses choix résidentiels et politiques. Dans ce contexte, la proximité avec ceux qui sont identifiés comme les bohémiens des années 2010 — les Roms — n’est pas fréquemment celle d’une expérience de vie, mais plutôt une connexion éphémère, une performance commune, une posture politique, artistique, le temps d’une « action », d’une fête, d’un spectacle. Avec le PEROU 36, c’est Israel Galván qui vient danser au bidonville de Ris-Orangis 37, Tony Gatlif parler de son film à celui de Grigny 38. Retour d’un imaginaire gitan, où le Gadjo 39 se libère au rythme de Django installé sur la Zone ? Peut-être, mais les rôles se sont inversés : ce sont les bourgeois qui font venir la fête dans le bidonville, y invitent des artistes « gitans », renforcent — si ce n’est produisent — la « bohémianité ». Après la performance, la bohème retourne à ses activités, enrichie par l’événement et ses suites médiatiques, académiques, politiques. Les bohémiens, eux, guettent l’expulsion. Qu’il s’agisse des bourgeois bohèmes ou du prolétariat artistique, on peut avec Jerrold Seigel considérer que la bohème n’était pas un domaine étranger à la vie bourgeoise, mais l’expression d’un conflit surgi dans son sein même
40. On peut critiquer l’engagement et les liens faibles du bobo, sa proximité conjoncturelle et fantasmatique, mais cela n’explique pas l’insulte que représente aujourd’hui cette désignation. La fascination des « bobos » pour la vie nomade, l’habitat précaire, l’art de la débrouille, la fête, l’anarchie est l’alter ego enchanté de la répulsion de l’administration et des pouvoirs publics en général, du communisme municipal en particulier, mais aussi des installés ou, au contraire, de ceux qui ont peur de basculer, eux aussi, du côté des sans.
Les choses sont un peu différentes à la Briche, avec le cirque Parada 41, ou, surtout, avec le Chapito de l’impasse Dupont : on y mixe des idéaux libertaires et anarchistes, le soutien militant et la vie foraine. La rencontre avec les bohémiens — les Roms — semble alors se faire de manière plus horizontale, et plus durable : à travers le partage des lieux et des compétences, les modes de vie deviennent poreux 42. Se nouent des liens d’amitiés, de respects mutuels, des fêtes mémorables. Avant leur expulsion pendant l’été 2010, au Hanul, un quartier de bidonville installé pendant 10 ans dans les arcades d’un aqueduc le long du RER D, ces deux types de « bohemianité » — anarchistes et « créatives » — se sont rencontrées. Coté « créatifs », de nombreux étudiants d’architecture, et Julien Beller, proposent des projets d’amélioration de l’habitat, testent des toilettes sèches 43. Bien avant l’expérience du PEROU, et alors même qu’une petite troupe de cirque, Parada, s’y est installée. En raison des actions des associations et des architectes, et peut-être aussi de sa situation, quasi invisible pour le reste de la ville, le Hanul est peu à peu considéré comme un quartier de la ville, et l’installation régie par une convention. Pendant l’été 2010, l’expulsion est un dommage collatéral de la politique de Nicolas Sarkozy. Depuis la destruction du Hanul, certains de ses habitants se sont installés sur des terrains, autorisés ou non, accompagnés un temps par les circassiens libertaires du Raj’Ganawak 44, avant, pour certains seulement, d’intégrer un quartier de préfabriqué. Une troisième proximité est celle des solidarités interpersonnelles, des associations ou des collectifs informels qui mobilisent parfois les mêmes personnes, mais obéissent à des logiques d’entraide et de solidarité de voisinage, sans recours à cet imaginaire de la bohème, au contraire : c’est le résident, l’habitant, le camarade de classe, le voisin, le citoyen, bref l’ordinaire d’une vie commune qui est mis en avant. Si cette relation n’est pas le sujet de cet article, elle est aussi importante qu’invisible.
Derniers nomades avant mobilité
Nomades et Roms errants
À Grigny, même dans cette extrême précarité chaotique, revit un peu la légende des Roms. Celle
d’une tribu prophétique aux prunelles ardentes (...) ou de vous autres Tziganes sans papiers(...) que l’écrivain JC Bailly rappelle, dans le livre comme quelque chose de perdu.
La fascination pour les nomades est partagée par nombres d’Occidentaux, à la condition d’une altérité reconnaissable et désirable — exotique, mais pas trop. Dans l’imaginaire touristique ou médiatique, la figure du Touareg blanc prend ainsi toujours le dessus sur le pasteur Peul, noir. Avec la guerre du Mali, les enlèvements, les attentats, le romantisme de l’Homme Bleu s’est quelque peu dissout dans el Kaida. En Europe, les voyageurs, les Tsiganes, les Romanichels, les bohémiens et tous les itinérants 46 ont fasciné les artistes, les écrivains, les musiciens, les anthropologues, parce qu’ils leur étaient « exotiques ». C’est aussi parce qu’ils étaient perçus et présentés comme nomades qu’ils ont constitué et constituent toujours un repoussoir des politiques publiques, et de la majorité des Européens, plus encore que toute autre population exogène. Comment cet imaginaire du nomade européen se fabrique-t-il ? Comment peut-il à ce point perdurer, malgré tous les travaux montrant l’inanité d’une telle projection ? Selon Henriette Asséo, 80 % des Tsiganes n’ont jamais bougé depuis le XVIe siècle
47. Par ailleurs, entre 80 et 85 % des personnes aujourd’hui considérées comme « Roms » en Europe sont sédentaires 48. Il y a bien sûr également des voyageurs, itinérants, partout en Europe, mais sans doute parce qu’ils sont moins présents et visibles dans les grandes métropoles, ils ne sont pas au centre de ces projections ambivalentes, mais deviennent les victimes collatérales des imaginaires nomades liés aux immigrés d’origine rom. La définition du Tsigane / Rom comme nomade trouve sa source dans les écrits savants du XIXe et XXe siècle ; elle s’inscrit, se sédimente notamment dans l’imaginaire politique européen, par l’intermédiaire du Conseil de l’Europe, qui indique en 1969 que les “Tsiganes” se caractériseraient par leur nomadisme
49. La résolution suivante croit déceler dans ce nomadisme la cause de leur pauvreté et des discriminations dont les Tsiganes seraient victimes 50. De Karl Marx à Manuel Valls, de Gustave Flaubert au PEROU, dans l’imagerie populaire, la littérature, les médias et les discours politiques, le nomade européen est ambivalent en ce qu’il oscille entre le bohémien fascinant et le Rom errant. Aujourd’hui, alors que la culture comme euphémisme de la race est devenue chose commune, voire assumée 51, les politiques s’attachent à « dénoncer » le caractère « irréductiblement différent de la culture rom » et « l’insécurité culturelle » des Français que cela engendrerait. De quelle différence irréductible parle-t-on, si ce n’est celle, immémoriale, supposée opposer nomades et sédentaires ? Le discours de l’incommensurable altérité se nourrit d’écrits essentialistes sur le « peuple rom » — dont Wikipédia — qui alimentent aussi la défense de ceux qui le considèrent comme le seul « vrai peuple européen », et louent la grandeur de ceux qui savent ne pas s’attacher aux choses matérielles des petits bourgeois. Tout ceci semble relever d’une même vision évolutionniste, ambivalente : ces nomades européens seraient la trace — misérable ou héroïque — d’un peuple venu d’ailleurs, du bout de la terre et du fond des âges. Un peuple primitif résiduel, situé au bas de l’échelle de l’évolution européenne, voire mondiale pour ses adversaires ; pour ses défenseurs, un peuple premier, résistant, l’exemple d’une communauté soudée, capable de vivre de peu, une sorte d’« âge de pierre, âge d’abondance 52 » à l’européenne. Pour les uns, un modèle du pire à venir, celui de la déliquescence des États-nations et des droits citoyens ; pour les autres, un exemple du meilleur, celui d’un peuple cosmopolite, donc pacifique, un peuple recycleur qui ne laisse pas d’empreinte écologique. Bref, venue du fond des âges et incarnation du futur, héros culturel ou ennemi ethnique, la figure du nomade paraît si importante dans l’imaginaire européen — comme rêve ou comme cauchemar — qu’il fallait bien trouver quelqu’un pour incarner cette altérité totale. Actuellement, donc, ce sont les personnes dites roms. Et pour se faire peur, il y a le « Rom migrant » absurde catégorie administrative 53 qui permet de faire perdurer l’errance dans les imaginaires. À l’instar du juif errant, le Rom migrant est toujours en route, il n’est jamais immigré, donc jamais installé. La construction de la catégorie de « Rom migrant » a permis aux pouvoirs politiques, administratifs et policiers d’assigner certains ressortissants européens, jugés indésirables, un statut à part, celui de l’errant, du nomade. Le Rom migrant, c’est le Rom errant, celui qui n’est de nulle part et qui constitue donc le parfait bouc émissaire, hier et aujourd’hui. Il faudrait se pencher sur les mythologies du juif errant, la production ambivalente du « peuple juif », pour comprendre tous les ressorts, et les risques, d’une telle dénomination. Bien sûr, pas plus que les juifs, les Roms ne sont migrants ou errants par vocation. Les populations dites roms s’installent dès qu’elles le peuvent. Ce sont les expulsions, les destructions qui les rendent errantes — Éric Fassin emploie l’expression de « nomadisme d’État 54 ». Le malheur des immigrés considérés comme Roms est que la destruction répétée et récurrente les assigne à ce statut de nomades presque toujours dépréciatifs, alors qu’ils cherchent simplement à s’installer, travailler, s’insérer. Nombre d’entre eux y parviennent, mais, dans ce cas, ils deviennent des immigrés roumains ou bulgares, et disparaissent des discours et des imaginaires, positifs ou négatifs. Compte tenu du contexte politique et sémantique de stigmatisation, les habitants, les militants et les associations qui interviennent dans les bidonvilles ont longtemps considéré que la meilleure protection était l’invisibilité. Pour autant, la conjonction d’un discours positif sur l’identité rom à l’échelle européenne et de politiques nationales de racisation ont objectivement concouru à rendre visible les bidonvilles comme « camps », donc comme lieux de vie étrangers et éphémères, tout en produisant leurs habitants comme des individus relevant d’une altérité radicale, donc ingérable. Sur les routes et dans les quelques emplacements où ils sont relégués, les voyageurs n’échappent pas aux discriminations et aux harcèlements quotidiens, alors même qu’ils ne font pas l’objet de la même projection évolutionniste liée au nomadisme. Le paradoxe n’est que d’apparence, puisque la réalité des pratiques compte peu au regard de la force des imageries, et de l’expérience de ceux qui les produisent. Les voyageurs évoluent en milieu rural, sur les routes, et ne rencontrent que rarement les médias, les élus et les jeunes urbains qui produisent la métropole dite « créative ». Ces derniers croisent des bidonvilles non des roulottes, des tentes ou des huttes. La figure du nomade s’estompe donc, également par la force de la médiatisation des expulsions de bidonvilles et l’apprentissage contrarié de la réalité : les Roms sont sédentaires.
Néonomades, Travailleurs mobiles
et pendulaires
Le monde contemporain va vers la mobilité alors qu’on fait tout pour arrêter les gens du voyage. Moi, je suis un vrai libéral, je pense qu’il faut laisser les gens faire leur vie, faire leur ville, leur truc.
Nous sommes des nomades. Pour nous, temporaire ne rime pas fatalement avec précaire. Les situations sur lesquelles nous travaillons peuvent nous mettre sur le chemin d’une avant-garde. Vers une ville correspondant à nos modes économiques et affectifs de vivre.
« Mobiles Lives / Forum / Vies mobiles. Préparer la transition mobilitaire » est un institut de recherche créé, dirigé, financé et présidé par la SNCF 58. Se présentant comme « transdisciplinaire, transfrontalier et transgressif », ce think tank associe et valorise, sur son site et ses blogs, des recherches sur les mobilités petites et grandes. Le « manifeste 59 » se donne pour objectif l’étude de la dialectique entre les déplacements physiques, les télécommunications et la mobilité sociale comprise comme façon de développer des sociabilités plus ou moins ancrées dans la proximité ou le lointain, le lent ou le rapide, l’urbain ou le rural, les changements de rôle, d’identité ou de statut
. La plupart des onglets ou titres de liens utilise un vocabulaire associé au monde alternatif ou artistique : « la communauté », « l’association », « le manifeste », « controverses ». L’institut est présenté comme « autonome » et « indépendant ». Les intentions et les sujets de recherches, les comptes rendus et les débats affichés sur le site et les blogs font de la mobilité
la valeur centrale de la vie humaine, un synonyme de liberté
. C’est dans ce contexte que sont par exemple confrontées deux enquêtes portant respectivement sur les « néonomades » et sur les « grands mobile ». Tout en pointant les différences liées à l’existence (ou non) et au statut d’un lieu de résidence principale, les auteurs semblent s’accorder sur l’idée que ces mobilités de travail résulteraient d’un choix — pionnier bien évidemment 60.
Si le nomadisme comme errance reste présent dans le discours répulsif, l’imaginaire du nomade consubstantiel, essentiel, a, semble-t-il, vécu. Aujourd’hui, l’enchantement vient d’une posture, d’un certain rapport au monde perçu comme détaché des contingences matérielles. Ce qui implique que chacun puisse devenir nomade s’il en accepte les contingences et en partage la philosophie — on revient à la bohème. Le plus souvent, et contrairement à ce que laissent penser « Forum vies mobiles » et les mentors du PEROU et du 6B, le néo-nomadisme est bien souvent une contrainte, liée à la précarité sociale et économique et à la remise en mouvement des travailleurs — qu’il s’agisse des immigrés roumains ou des travailleurs du nucléaire 61. Les habitants des bidonvilles ne sont pas nomades, ils ne sont pas non plus « installés ». C’est ce qui angoisse les uns et fascine les autres : n’avoir pas de lieu ou plutôt appartenir à plusieurs espaces, avoir plusieurs chez soi, une double absence 62, mais aussi une double présence 63, ce qui va à l’encontre du discours identitaire classique, mais raisonne agréablement dans l’imaginaire transnational de la mobilité créative. D’une certaine manière, les déplacements des classes urbaines cultivées, et des habitants des bidonvilles d’Île-de-France originaires d’Europe centrale sont, de ce point de vue uniquement, structurellement proches : tous sont des pendulaires, avec des mobilités non quotidiennes, mais lointaines et fréquentes. Si l’on reprend les catégories du « Forum mobile », les familles roumaines, roms ou pas, sont de grands mobiles, non des néonomades. Comme le note Arnaud Le Marchand, les pendulaires CSP+ érigés en modèle de mobilité et de liberté ne sont en rien des précurseurs, ils représentent l’infime partie, socialement enchantée, des travailleurs mobiles : le « technocrate ou l’analyste transhumant » que Deleuze et Guattari qualifiaient de « sombre caricature » de l’ouvrier nomade cite.
Européen, transnational, cosmopolite
« Notre patrie, c’est l’Europe », ou les Roms : un patrimoine européen
Les imaginaires se structurent à travers les images, les paroles et les idées en circulation, c’est-à-dire les médias, la littérature, la musique, ou encore Wikipédia, encyclopédie sans doute devenue la première source d’information des terriens connectés. Objet d’une intense activité d’écriture / réécriture, la page « Roms » de Wikipédia 64 ne s’appuie que de manière très partielle sur les travaux historiques et scientifiques. En revanche, elle permet d’appréhender la manière dont se produit et s’argumente une identité commune rom à la suite du Congrès tsigane mondial de 1971 65. Alors qu’il fut un terme « savant » retenu dès le milieu du XIXe, au moment où le langage courant utilisait le vocable de Bohémiens, et reste central d’un point de vue académique — confère les « Études Tsiganes » et la revue éponyme 66, il n’y a pas, sur Wikipédia, de page spécifique pour ce terme qui renvoie au terme Rom. Ce dernier est utilisé, selon la définition du Congrès de 1971, pour désigner un ensemble de populations, ayant en commun une origine indienne
. Ce mythe originel obéit au même schéma narratif que celui d’une origine commune juive. Paradoxalement, ce mythe d’une origine indienne fonde la justification du caractère « authentiquement » européen car transnational des « Roms ». La page Wikipédia reflète également la vision politique du Conseil de l’Europe, préoccupée depuis sa création par la construction d’une identité européenne, préoccupations actualisée par la volonté de créer un « Institut de la culture Rom 67 », avec le soutien financier de l’Open Society de Georges Soros 68. Si les Roms sont fondamentalement européens, alors « leur » culture devient-elle un « patrimoine européen » ? À moins que cela ne soit l’inverse ? « La culture rom, un patrimoine européen » est en tous les cas le titre et le thème de l’une des routes du Conseil de l’Europe, créée par l’Institut Européen des Itinéraires Culturels, à côté de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, de la route des Cisterciens, ou encore de celle des Phéniciens 69. L’itinéraire est lancé en 2010, dans 7 pays, dont la France, alors que l’été est marqué par le discours de Nicolas Sarkozy à Grenoble 70, suivi de multiples expulsions, dont celui du bidonville du Hanul à Saint-Denis, et de la réaction indignée de Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne 71. Les initiateurs de cet itinéraire européen annoncent alors des circuits de visites touristiques. Au cours d’un reportage réalisé en Slovénie, Euronews explique que la mise en tourisme de villages roms est un moyen de faire mieux connaître et comprendre cette culture auprès des touristes, mais aussi, et surtout, des riverains 72. En 2014, il semble que cette initiative n’ait pas rencontré le succès escompté, et l’itinéraire est resté au stade de la localisation sur une carte d’un consortium d’associations et de musées consacrés aux Roms, Tsiganes ou voyageurs. À l’été 2015, l’itinéraire créé en 2010 a disparu des listes. Les actions sont désormais présentées sous le titre « Ressources culturelles pour l’inclusion des Roms 73 », comme si la « culture » dont il est question leur était extérieure. Seul un réseau universitaire et militant 74 lié à l’Open Society reste actif 75. En France, cette volonté de patrimonialisation européenne a plutôt, semble-t-il, exacerbé les défiances : il a fait resurgir le spectre de l’apatride forcément traître, en permettant l’amalgame de toutes les familles assimilées de près ou de loin à des voyageurs, des gitans, des romanichels, etc. À l’inverse, l’imaginaire d’une nation non inféodée à un État, la figure d’un peuple partageant une culture commune sur l’ensemble du territoire de l’Europe fascine. Et c’est ce qui explique son ambivalent succès : il permet de concilier l’originel et l’original, le pré et le postmoderne, l’artiste bohème et l’anarchiste, le mobile cosmopolite et le citoyen du monde. En la personne du Rom, on a enfin trouvé LE citoyen européen, récipiendaire de notre patrimoine, de notre passé commun, et de notre avenir, transnational assurément.
« On fait cela pour tout le monde ». Un décor cosmopolite
La FAR, c’est l’ouverture à l’extérieur, un espace vert extraordinaire, activée avec une programmation. Y’a un bidonville en face qui nage dans le canal, un bac à sable où les gamins du foyer social à coté viennent, y’a les stands de Congolais, impression d’être à Kinshasa, mais aussi la baronne de Paris qui venait faire des concerts. Ça nous a légitimés auprès du quartier. On disait "les bobos de Saint-Denis". Mais on fait cela pour tout le monde.
Être chez moi signifie vouloir laisser un terrain habitable à nos enfants.
Les images et imaginaires liés aux populations précaires correspondent terme à terme aux travaux et aux engouements pour la condition postmoderne et transnationale : l’idée, très développée dans le monde de la recherche anglophone, que l’État-nation est mort, et que les individus et les collectifs se pensent et se produisent dans une interaction entre le très local — le voisinage — et le très global. Une communauté imaginée qui ne serait plus celle de l’État-nation décrit par Benedict Anderson, mais celle d’Arjun Appadurai 78 : la rencontre entre la localité cosmopolite des créatifs et des migrants connectés, et le voisinage transnational précaire des bidonvilles. Alors même que les expériences de la ville et de la vie sont profondément différentes, voire divergentes, les artistes des friches artistiques et culturelles peuvent, avec plus ou moins de sincérité ou, au contraire, de distance cynique, considérer qu’ils partagent un espace commun, une scène urbaine commune, un enrichissement réciproque. Il y aurait alors la possibilité d’une communauté cosmopolite, inter et transnationale, fondée sur un voisinage où chacun a besoin de l’autre et de ses qualités, comme ressources, comme décor, comme objet ou comme sujet. À Saint-Denis se rejoignent les imaginaires des élites mobiles de Après le colonialisme (Modernity at large 79) et la réalité vécue de Condition de L’Homme global 80. Comme toute communauté, la communauté cosmopolite est imaginée, mais elle se distingue par son aterritorialité. L’imaginaire cosmopolite promue par le 6B s’ancre dans la possibilité de considérer les résidents, les visiteurs et l’ensemble du quartier comme une scène multiculturelle, transnationale, transgressive.
Utopie et dystopies communautaires.
Des bidonvilles qui se succèdent aux artistes résidents, en passant par les nombreux squats (artistiques ou non), on trouve, aux deux extrêmes de l’échelle sociale, des pratiques et un rapport au territoire métropolitain que l’on pourrait qualifier de comparables : une communauté de vie, une entraide parfois forcée, mais réelle, des mobilités différentes de celles des banlieusards habituels. Cette communauté partagerait une relation diffractée à l’espace professionnel, mais aussi amical et familial. Contrairement aux déplacements longs et quotidiens des banlieusards, on alterne plutôt entre une vie de voisinage liée aux activités professionnelles ou économiques, un entre-soi très marqué, et des mobilités lointaines, et fréquentes, le tout en fonction des occasions ou des obstacles. Tout ceci, bien sûr, dans des conditions matérielles très différentes.
À la Briche, cet esprit se retrouve dans un certain nombre de pratiques : bar collectif, fanfare, nombreuses fêtes privées... Si l’entre-soi y est également fort, la position du 6B est plus ambivalente, en ce qu’il est d’abord un lieu de travail pour des Parisiens qui se côtoient, mais n’adhèrent pas tous, tant s’en faut, au projet et au collectif et un lieu de voisinage qui anime son fondateur, Julien Beller. Ce dernier regrette notamment que les résidents se comportent souvent comme des consommateurs de bureaux et ne s’investissent pas assez dans l’organisation et l’action collectives, dans la volonté de « faire ville » par leur présence même.
Si certains trouvent que c’est « trop popu 81 », d’autres que c’est « trop pointu », les projets collectifs et communautaires du 6B et de la Briche ne posent problème à personne en tant que tels. En revanche, le « regroupement communautaire » dans les bidonvilles, l’habitat insalubre du centre-ville ou le logement social sont l’objet d’une dénonciation récurrente. La communauté culturelle est une utopie positive, émancipatrice, lorsqu’elle est portée par des artistes, des artisans, des créatifs. Mais pour ceux dont la « culture » serait un « problème », le « regroupement communautaire » enferme les individus et empêche leur intégration. Avec l’allusion à une « culture rom » du campement, le culturalisme des pires moments de l’histoire de l’anthropologie permet de tenir un discours raciste euphémisé. Pourtant, si les Brichoux entretiennent une utopie post-hippie de la vie communautaire, les habitants des bidonvilles environnants souhaitent quitter une communauté de vie et une entraide sociale qui sont d’abord des nécessités de survie : le bidonville est pour eux une dystopie communautaire.
Communes communautés : localités et voisinages
À Saint-Denis, utopies et dystopies se croisent. Entre la Briche, le 6B et les bidonvilles alentour se sont créées des communautés de voisinage, d’intérêts et / ou d’amitiés : plusieurs familles des bidonvilles fournissent en ferraille et en objets métalliques le sculpteur Nicolas Cesbron, fondateur de la Briche, ou font la cuisine pour quelques-unes des nombreuses fêtes pantagruéliques de la Briche. Qu’il s’agisse d’un nouveau bidonville, d’une baraque à frites ou d’une installation militante, la construction de cabanes donne lieu à des échanges de compétences et d’expériences. Julien Beller et plusieurs générations d’étudiants de l’école d’architecture de la Villette 82 sont intervenus dans les bidonvilles de Saint-Denis en apportant aide à l’installation de toilettes sèches ou à la réfection de baraques, tandis que, avant sa destruction, les enfants du bidonville voisin avaient leurs habitudes au festival estival du 6B, la Fabrique à Rêves. Invité à programmer une soirée au musée Delacroix à Paris dans le cadre du Printemps des Poètes, le 6B fait se produire le groupe de danse « tsigane et moyen oriental » Ćhave Sumnakune 83, né au Hanul 84. Le voisinage du 6B et des bidonvilles du territoire est rendu possible par une proximité spatiale, mais aussi, et sans doute surtout, par la production concomitante d’une communauté imaginée, celle d’un rapport commun, transgressif, qu’il soit voulu ou subi, aux normes sociales et urbaines. Cette communauté imaginée, les images et les récits qui la constituent produisent une localité, c’est-à-dire une série de liens entre le sentiment de l’immédiateté sociale, les technologies de l’interactivité et la relativité des contextes
85. La coproduction du voisinage et des localités qui a lieu à Saint-Denis paraît assez spécifique. Pour la plupart des autres échanges en Île-de-France, on assiste à un décalage, voire à un conflit, entre, d’une part, l’activation d’un voisinage solidaire, et, d’autre part, les interventions politiques, artistiques qui produisent de la localité telle que définie par Appadurai. C’est le cas dans l’Essonne, où le PEROU, animé par Sébastien Thiéry, produit une communauté imaginée, artistique et politique et des symboles d’une grande efficacité médiatique, sans s’ancrer dans une communauté de voisinage pérenne, qui, elle, s’organise autour d’un collectif militant proche du PC, occupé au quotidien à accompagner les familles des bidonvilles. Pour autant, et comme le montre la médiatisation du PEROU, cette communauté imaginée n’a pas besoin de relations de voisinage pour s’imposer. L’efficacité concrète compte moins que la possibilité d’un plaidoyer qui, du plus libertaire au plus libéral, associe les bénéficiaires et les victimes de la libéralisation économique et de la globalisation des flux culturels. Pour comprendre Sébastien Thiéry et le PEROU, Julien Beller, le 6B et le Hanul, il faut revenir à leurs origines communes, Les enfants de Don Quichotte 86, qui en plantant leurs tentes rouges le long du canal Saint-Martin en 2006, installèrent la question des SDF et de l’habitat précaire dans le paysage médiatique. Thiéry devint expert en design politique, tandis que Beller en tira la conviction qu’il fallait occuper les interstices et y faire de la ville.
Temporaire, précaire et provisoire :
campement, baraque et bidonville
De Cabanes en Baraques, l’insouciance et la précarité.
Les cabanes ignorent les catégories juridiques du bâti et du non bâti, du dedans et du dehors, du naturel et de l’artificiel. Étant tout à la fois, elles échappent aux grandes juridictions habilitées à légiférer sur les territoires urbains, ruraux et naturels ; elles constituent sur leurs marges des refuges contre ces machines à écarteler. Elles relèvent de l’insupportable univers du flou.
Aujourd’hui, la construction de cabanes ne concerne plus qu’une infime partie de la population (scouts, auto-constructeurs amateurs, pêcheurs, chasseurs, et enfants).
Si cabane et baraque sont au départ synonymes, si le terme de « baraque » n’est pas péjoratif pour beaucoup de ses habitants, une dissociation en valeur s’est largement imposée. La baraque est la bicoque, caractérisée par son aspect bancal et précaire, la pauvreté des matériaux et des capacités de construction. La cabane renvoie à un imaginaire du refuge, du cocon, de l’intime, du provisoire, de l’interstice. Une deuxième maison, un abri temporaire, de loisir. La cabane est ce qui permet de s’éloigner temporairement du quotidien, tandis que la baraque est un quotidien sordide, marquée d’une infamie : celle de la pauvreté, de la précarité, mais aussi de la coupable insouciance, les maisons de paille et de fagots de bois du conte des Trois petits cochons. Dans la version originelle, non encore édulcorée par Walt Disney, les deux petits cochons (ou oies) qui ont bâti en paille et en bois sont dévorés par le loup, symbole de l’adversité. Ils sont mangés, punis, parce qu’ils n’ont pas su prendre le temps de bâtir en dur, trop occupés à danser et à jouer de la musique 89. Trop de gaîté, trop d’insouciance ? C’est aussi la morale de la Cigale et de la Fourmi 90, que Gustave Doré grave sous les traits d’une jolie gitane rejetée par une matrone alsacienne.
La Cigale et la fourmi. Gravure de Gustave Doré d’après les Fables de La Fontaine.
Crédits - Gustave DoréLe même imaginaire, inversé en valeur, anime nombre de soutiens : la fascination pour la fête, la musique, l’insouciance. Le collectif PEROU se mobilise d’abord pour construire une salle des fêtes dans le bidonville de Ris-Orangis, puis invite le danseur flamenco Israel Galván, et ensuite, à Grigny, Tony Gatlif. Personne ne note que les rôles se sont inversés : c’est la bohème qui produit la fête, renforce si ce n’est produit la « bohémianité » des habitants du Bidonville. Ceci ne lasse pas d’étonner, voire d’agacer certains, pentecôtistes ou évangélistes, qui considèrent que l’on ne chante que pour Dieu. Dans De baraque en baraque. Voyage au bout de ma rue, Cendrine Bonami-Redler 91 dessine les baraques construites par des personnes installées au bout de sa rue, sur un terrain de la zone des murs à pêches, à Montreuil. Anciens agriculteurs venus de Roumanie, les habitants se sont installés là avec un bail et ont reconstitué la structure d’un petit village de la région d’Arad à l’ouest de la Roumanie. Ils y cultivent des potagers et accueillent les visiteurs dans leur Hôtel Gelem 92. Cendrine Bonami-Redler a logé dans cet hôtel, dessine avec finesse ce petit quartier autoconstruit et nous raconte l’histoire villageoise de ces personnes, tout en employant systématiquement — à une occurrence près — les termes de « camp » ou « campement ». Comme s’il lui était impossible, malgré ce qu’elle a vu, raconté, dessiné, de considérer l’ensemble de ces habitations pour ce qu’il est : un quartier autorisé de baraques de bois, issu de l’exode rural de paysans venus de Roumanie. Quelle que soit les réalités historiques ou contemporaines, pour la bohème, le bohémien ne saurait être ni villageois, ni paysan. Son habitat se doit d’être temporaire, d’un point de vue collectif comme individuel.
Campements nomades ? Du campement au camping et retour
L’État doit comprendre que la sédentarisation exclusive et pérenne est dépassée. Les migrants augmenteront proportionnellement aux désastres écologiques et économiques prévisibles.
« Le Grand Pari de PEROU », Objectif Grand Paris 93
Le nomadisme des habitants des bidonvilles est lié, on le sait, à la destruction systématique et répétée de leurs précaires maisons. Selon Éric Fassin, environ 400 000 Roms vivraient en France, dont 15 000 dans des bidonvilles, sans doute moins puisque d’autres personnes d’Europe centrale — roumaines, bulgares — y vivent également. Comme les générations qui les ont précédées, les habitants des bidonvilles ne sont nomades ni de nature ni de culture. Et les bidonvilles sont des protovilles bien plus que des campements. C’est pourtant le terme de « campement illicite » qui a été retenu par l’administration et repris par tous. Logique : les nomades vivent dans des campements, n’est-ce pas ? Pour renforcer le caractère temporaire, c’est le terme de camp, et de campement, qui s’est imposé pour parler de l’habitat précaire des immigrés venus d’Europe centrale. Les termes de camp ou campement assignent ses habitats au temporaire et au précaire, renforcent l’idée que leurs habitants n’en sont pas : ils sont de passage. C’est bien ce à quoi travaillent les pouvoirs publics : faire circuler. De plus, les termes de camp et campement renvoient soit à l’enfermement, soit à une armée de campagne, tout rapprochement sans doute utile politiquement pour légitimer l’éradication et nier la ville qui s’y produit. Mais comment nommer les habitants des « campements illicites » d’Île-de-France ? Des campeurs ? Impossible, ils seront donc nomades. Le « nomade » vit dans un « campement illicite », le « camp rom ». CQFD. L’enjeu politique et administratif d’une telle construction sémantique est claire : il faut « altériser » ces européens pour justifier leur exclusion. Mais cette victoire dans l’imaginaire ne serait pas possible sans le succès médiatique de cette notion et sa reprise sans discussion par des acteurs militants aux finalités radicalement opposées. Qu’est-ce qui peut expliquer la fascination / répulsion et le succès politique et médiatique du « camp », comme catégorie et expression instituée ?
De fait, le camp et le campement renvoient à une réalité sociale appréhendée avec la même vision essentialiste et primitiviste que le nomadisme. Dans leur article « De quelques formes primitives de classification. Contribution à l’étude des représentations collectives » paru en 1903, Marcel Mauss et Émile Durkheim considèrent le campement comme une forme d’organisation sociale fondamentale 94. Olivier Sirost note que ce fait social total a été réapproprié en Europe par le campement de loisir, le camping 95. L’intérêt, la fascination pour l’habitat mobile, temporaire, précaire ne sont pas nouveaux : la bourgeoisie transgressive du XIXe, les bourgeois bohèmes du Touring club de France, comme les pionniers du tourisme américains visitaient déjà roulottes et cabanes pour les reproduire, tout en inversant la valeur : du marginal à l’exceptionnel 96, du campement au camping, de la roulotte au mobil-home. Le camping, c’est aussi, comme le note Olivier Sirost, une culture technique qui se développe autour de l’habitat alternatif et temporaire. Après une période de massification et de dévalorisation du camping, ce mode d’habitat de loisir redevient désirable, alors que se multiplient les offres d’hébergements exotisantes : yourtes, huttes, tipis et roulottes, ou encore maisons de trappeurs. Enfin, en 2011, alors que la sémantique institutionnelle du « camp rom » et du « campement illicite » s’était fermement installée en France pour justifier les expulsions, le campement est soudainement devenu, sur la scène mondiale, synonyme d’occupation politique, contestataire, de Occupy wall street 97 à la place Tarhir 98. Il s’est peut-être produit alors une dissociation entre le camp, associé à l’enfermement, et le campement, produit comme acte de contestation 99.
Squats et friches
À Saint-Denis, comme dans les autres villes de cette partie du 93, les friches et les bidonvilles sont partout. Alors que 40 % du centre-ville ancien est considéré comme insalubre, les conditions de vie dans les immeubles délabrés ou les garages des vendeurs de sommeil, souvent sans eau ni électricité, ne sont guère meilleures que dans celles des « campements illicites ». Qu’il s’agisse de squats ou de locations illégales, qu’il s’agisse de propriétaires privés ou de logements sociaux investis à l’occasion d’un départ de locataire, le passage y est temporaire, au rythme des expulsions. Selon Thomas Aguilera, environ 1 000 immeubles sont squattés seulement à Paris, alors que 7 000 personnes vivent dans les bidonvilles d’Île-de-France, principalement dans le 93 100. Le nombre de personnes concernées par la vie en squat est donc très supérieur à celui des habitants des bidonvilles. Thomas Aguilera distingue les « squats discrets » ou squat de pauvreté, de loin les plus nombreux, les plus invisibles et les moins étudiés, des squats revendiqués, objets de nombreuses enquêtes sur les mouvements alternatifs et les revendications collectives. Les squats discrets le sont car les pouvoirs publics n’ont aucun intérêt à rendre visible une situation qu’ils ne sauraient résoudre. C’est donc l’absence de données, l’invisibilité politique qui fait que le problème n’existe pas. Un rapport portant sur les squats collectifs ou l’occupation d’appartements de bailleurs sociaux estime que les deux populations résidentes majoritaires sont les personnes originaires d’Afrique subsaharienne et d’Europe centrale, en particulier de Roumanie 101. Lorsqu’il s’agit de squatter un bâtiment en « dur » ou un logement social, on parle de populations d’Europe centrale, alors même que, comme le note Martin Olivera, les immigrés roumains qui se définiraient comme roms ne vivent pas, pour leur grande majorité, dans des bidonvilles 102. On ne spécifie pas non plus l’origine dite « ethnique » des personnes venues d’Afrique subsaharienne. C’est donc le bidonville, le « campement » qui fait le Rom. Pour autant, et comme le note Thomas Aguilera, les travaux ne se rejoignent pas, chacun jugeant que le phénomène et les populations sont très différents. Surtout, les valeurs associées sont antagonistes. La « friche » et le « squat artistique » n’impliquent pas forcément une occupation illégale : le 6B et la Briche sont régis par des conventions, des baux et des loyers. Les désigner comme friche, avec l’imaginaire du temporaire qui lui est associé, confère une aura particulière, une valeur de contre-culture, une esthétique de la bohème, une politique de la transgression. Avoir l’air d’une friche, même si on ne l’est pas — ou plus, c’est aussi s’affirmer comme le front pionnier de la métropolisation créative. Pour le public, le caractère provisoire, éphémère, crée du désir, l’urgence de l’événement à ne pas manquer. Une friche culturelle n’est pas mobile, c’est, à l’instar d’un champ en jachère, ou d’un rite d’initiation, un moment intermédiaire, une zone de marge qui permet de déstabiliser une identité pour en construire une autre. Un temps front pionnier et zone liminaire, le 6B n’est plus une friche, mais un lieu culturel donnant une plus-value à un programme immobilier, et le cœur d’un quartier en construction. La friche temporaire — pléonasme — est une étape de la production de la ville. L’imaginaire de la bohème et le désir de transcendance vis-à-vis de l’ethos de propriété rendent la friche désirable en soi et pour soi, à condition d’être éphémère. Ensuite, soit on installe, on transforme en habitat et en habitants, en résidences et en résidents, soit on renvoie au néant. Au 6B, la friche, entourée de bidonvilles et de stands congolais, fut une réalité éphémère. Toutefois, l’intervention de son mentor dans les bidonvilles et ses prises de position publiques permettent de sauver l’hétérotopie, celle d’une occupation temporaire, marginale, transgressive, créative.
Friches et bidonvilles, des protovilles
Dans l’imaginaire politique, le campement et le squat impliquent un départ, le bidonville et la friche une installation. On peut bien sûr opposer les résidents des friches culturelles, créatives ou alternatives, aux habitants des bidonvilles, en ce que les premiers constitueraient le pont avancé de la gentrification, et du capitalisme libéral, tandis que les seconds en seraient les victimes. Il convient toutefois de rappeler que, au départ, la gentrification désigne plutôt l’élévation sociale des quartiers populaires anciens. Or, si l’on peut noter une petite gentrification du centre ancien de Saint-Denis, ce qui marque le territoire de Confluence est l’occupation précaire, formelle ou informelle, licite ou illicite d’espaces détruits, ou pour le cas du 6B, de bureaux désaffectés. Il s’agit donc de l’installation, sur un territoire de terrains vagues en rapide transformation, des bénéficiaires et des victimes de la globalisation — culturelle comme économique. Le bidonville, comme la friche, ne s’installe pas en centre-ville. Ce sont les deux faces de la protoville et, comme le notait déjà Colette Pétonnet 103 en 1979, le bidonville est une aire transitionnelle qui permet le passage d’un statut à un autre 104. Dans ces espaces intermédiaires, la friche augure d’une mise en culture prochaine, tandis que le bidonville fait peur : il déploie à la vue de tous, dans l’espace d’un bord de canal, d’autoroute ou de RER, l’insécurité sociale. Pour certains, il rappelle la vie des parents, des grands-parents, pour d’autres, parfois les mêmes, il incarne un possible, l’ordre du pire. Ce n’est sans doute pas l’habitant précaire qui fait peur ou révulse, mais le passé ou le possible partage de sa condition, incarnés par les baraques fumantes agglutinées le long des voies. Mais ce souvenir est aussi la possibilité d’une solidarité. Pour ceux qui ne partagent pas la même histoire, le bidonville incarne à la fois une condition cosmopolite, la vie de proximité, la production de la ville de demain, un idéal de l’autoconstruction, de la liberté. Pour les pouvoirs publics, qu’il s’agisse de l’État ou, plus encore, des municipalités, ne pas parler de bidonville, mais de campement est un acte politique : c’est vouloir faire oublier le passé souvent proche des villes concernées, empêcher la constitution d’un voisinage lié à la reconnaissance d’une expérience partagée, et enfin, refuser le statut de citoyens en devenir aux habitants du bidonville. C’est, de manière symétrique, la raison pour laquelle un nombre grandissant d’associations et de collectifs militants tentent de le rendre visible et dicible.
Dans l’imaginaire politique, le campement implique un départ, le bidonville une installation.
Inspiration, expérimentation :
rebuts et recyclage
Homo sacer, homo faber, Recyclage et réemploi
La situation du bidonville est catastrophique, et, en même temps, on y constate la plus grande intelligence de l’individu qui fait, peut-être parce qu’il est poussé par la nécessité. On peut dire que dans un bidonville il y a 99 % d’intelligence et 1 % de moyens, alors que généralement, plus il y a de matière, moins il y a d’intelligence . Cette vison établit une relation directe entre la pénurie de ressources et la capacité créative et réflexive.
Les grands architectes qui font des tours à Dubaï sont hors sujet pour les habitants de Ris-Orangis, c’est le bidonville qui sera le terrain de travail des architectes de demain.
Si l’on regarde le bidonville depuis ses rives, par exemple à travers les fenêtres d’un RER en route pour l’aéroport, on ne voit que baraques fumantes et monceaux d’ordures, et l’on perçoit la normalité de l’état d’exception, l’homo sacer d’Agamben 107, les rebuts de la vie liquide décrite par Zygmunt Bauman : le (mauvais) traitement des déchets humains. Pourtant, ces déchets ne sont plus aujourd’hui univoques : les valeurs écologistes, l’idéal du recyclage et l’architecture rhizomique sont passés par là. Ce qui pousse les jeunes architectes vers ces bidonvilles est la puissante forme critique de la « pensée nomade 108 » de la société capitaliste qu’ils pensent y rencontrer. Le déchet, le rebut, le reste sont donc au cœur des ambivalences ici étudiées. La construction faite de matériaux de récupération, c’est-à-dire des restes de la société industrielle, suscite chez les uns le dégoût, chez les autres, la fascination. Intitulée Matière grise, une exposition au pavillon de l’Arsenal 109 — et l’ouvrage éponyme 110 — est tout entière consacrée aux projets d’architectures conçus à partir de réemploi. À l’origine de cette exposition, il y a, pour ses concepteurs, l’expérience du gâchis, celui du départ à la benne de mobiliers et de matériaux utilisés pour une exposition dans des wagons de la SNCF. Le propos est d’abord écologiste, l’enjeu énoncé dès l’introduction intitulée « Le navire mondial et son équipage » :
Nous souhaitons humblement explorer les conséquences environnementales directement liées à l’exercice de notre profession, pour rejoindre ceux qui cherchent la légèreté du moindre impact, animés par la joie de construire 111.
Plus d’une dizaine des projets présentés dans l’exposition et le catalogue sont des installations réalisées dans des bidonvilles, ou à destination de populations qui y vivent ou y vivaient (logement provisoire Emmaüs, PEROU à Ris-Orangis et Grigny, bâtiment commun à Montreuil ou en Bretagne). Le bidonville n’est pas seulement un terrain d’expérimentation pour des générations d’étudiants, il est aussi, explicitement, une source d’inspiration. Ainsi, Patrick Bouchain, pionnier et mentor de ce courant, explique-t-il à propos de la conception de l’Académie Fratellini, une école de cirque sise à Saint-Denis 112 :
Je me suis souvenu de ce que l’on fait dans les bidonvilles où l’on y assemble des tôles par recouvrement pour cacher les trous.
L’autonomie, l’autoconstruction, l’adaptation et la liberté vis-à-vis des normes constructives fascinent les architectes quotidiennement aux prises avec des normes en tout genre. Comme nombre d’ethnologues, ils perçoivent — fantasment — mais aussi produisent le bidonville comme un espace collectif de conception et de construction solidaire. Un bidonville, finalement, est ce que cela ne serait pas une sorte de grand fablab de coworking biffin ?
Minerai urbain, minerai humain
Bidon-ville, c’est le bidon qui nous rappelle qu’à tout moment, à un moment ou à un autre, nous serons par décret, déchets et ordures.
Le traitement des déchets est (...) l’un des deux grands défis que la vie liquide ait à affronter. L’autre grand défi est la menace de devenir un déchet.
En 1978, paraissent deux numéros de la revue Traverses consacrés aux restes 116, bientôt suivi en 1984 d’une exposition du défunt Centre de création industrielle 117 intitulée « Déchets, l’art d’accommoder les restes ». La lecture contemporaine de ces publications montre le chemin parcouru : à la fin des années 1970, l’idée même du recyclage des déchets commence juste à apparaître et semble encore, pour beaucoup, incongrue. Mais la posture intellectuelle n’est pas si différente des collectifs artistiques actuels. Au Comptoir Général 118, bar branché du Xe arrondissement de Paris, le succès vient de la mise en scène et en marché de la culture « ghetto », avec des corners thématiques, meublés, où tout est à vendre. Le bon marketing est celui qui sait raconter une histoire, donner vie à l’objet et par là en susciter le désir. Grâce à son « service de philanthropie opérationnelle », le Comptoir Général travaille avec les biffins d’Île de France. Ceux-ci fournissent le bar en meubles, objets et récits qui font sa plus-value et sa notoriété — 20 000 « visiteurs » par semaine. Les friches, les bidonvilles et leurs habitants constituent aujourd’hui un amer, un pivot permettant de penser la genèse, le passé et l’avenir de la métropole francilienne, pour le meilleur et pour le pire. La friche et le bidonville sont au choix des brouillons ou des esquisses d’urbanité, de ville en devenir, de ville immatérielle. Leurs habitants, les rebuts d’une société qui meurt ou l’écume de celle qui vient.
L’étrange paradoxe de notre société est que son avant-garde prend pour modèle et terrain de jeu, les manières de survivre de l’homo sacer de notre démocratie contemporaine. Ce paradoxe s’explique sans doute par ce qui, pour Zygmunt Bauman, caractérise l’hybridité culturelle :
Tout comme dans les réseaux extraterritoriaux traversés et les “nowherevilles” habités par la nouvelle élite globale, la “culture hybride” recherche son identité dans le fait de ne pas être à sa place : dans la liberté de braver et de ne tenir aucun compte des frontières qui brident les mouvements et les choix des autres, ces inférieurs — les “gens du coin”.
N’en déplaise à Bauman, pour la culture hybride, devenir un déchet n’est plus une grande menace, mais la promesse d’un recyclage et de l’incorporation dans le système de valeurs — valeurs symboliques, matérielles, professionnelles et économiques — des élites d’avant garde, créatives. Pour le moment, les bidonvilles sont à la fois les espaces d’expérimentation de précurseurs enthousiastes et le lieu de vie et de travail des pauvres et des artisans recycleurs de nos métropoles. Demain, tous seront balayés par l’industrie et la finance de ce que, en 1984, à l’exposition de Beaubourg, on nommait le « déchet Minerai », devenu « minerai urbain ».
Conclusion
Tandis que les nouveaux emplois tertiaires créés sur le territoire, notamment dans les industries créatives, s’adressent prioritairement aux cadres et non à la population locale 120, en moyenne peu qualifiée, et que des signes de gentrification se manifestent, la métropolisation attire non pas la très fantasmée classe créative 121, mais plutôt la (petite) bourgeoisie intellectuelle — enseignants, artistes, employés du territoire, salariés des mondes associatifs et culturels. Tous ont intérêt à retarder la production de la ville des classes moyennes, la production de logements, le remplissage des interstices. Ils n’ont bien sûr pas exactement la même capacité à influer sur leur installation et le devenir de ces espaces. La valeur donnée à la mobilité et au temporaire est quelque chose de nouveau à Saint-Denis et marque une inflexion politique des collectifs de solidarité. En effet, dans la décennie précédente, et c’est encore le cas pour les réseaux les plus actifs sur le territoire, c’est le caractère d’habitant, le fait de rester, d’habiter, qui est un argument déterminant pour s’impliquer, notamment dans la défense des sans-papiers. On trouve également de nombreux militants libertaires, moins visibles mais plus présents dans le quotidien des luttes pour la survie. Comme ces derniers, ce qui pousse nombre de jeunes architectes vers les bidonvilles, est la « pensée nomade 122 » critique de la société capitaliste qu’ils y pensent rencontrer. Contre cet alliage hétéroclite entre voisins, libertaires et libéraux, le contre-feux classique — mantra du communisme municipal — consiste à dénoncer l’imaginaire cosmopolite du nomade, de la mobilité, de la transgression des normes comme une attaque des acquis démocratiques : du droit au logement, de l’État-providence, de la solidarité nationale et locale. Pour reprendre la métaphore de John Urry, cet imaginaire nomade marquerait l’acception du passage de l’État jardinier (l’État-providence) à celui de l’État garde-chasse 123, où, comme le note Saskia Sassen, les dominants n’ont plus besoin d’être citoyens, et peuvent de surcroît présenter la vie flamboyante dans ce hors-norme, ce hors-société comme une valeur personnelle, une virtu qui ne doit plus rien à l’État ou aux solidarités nationales. Toutefois, force est de constater que cet imaginaire bohème, tout contestable qu’il soit, améliore la survie, là où la démocratie ne sait plus qu’empêcher la vie, où les droits (soin, école, logement) sont partout bafoués par ceux qui s’en devaient les garants, quelle que soit leur couleur politique. La bohème créative pose un regard romantique et libéral sur une réalité qu’elle accompagne, voire justifie, mais dont elle ne serait être tenue pour responsable. L’imaginaire de la bohème possède depuis toujours ce caractère ambivalent. Mon texte s’est proposé d’en décrire la réactualisation à partir de l’exemple de Saint-Denis. Dans les bidonvilles, au bord des routes, et dans les squats insalubres, des hommes, des femmes et des enfants cherchent à construire leur vie, malgré leur statut de bouc émissaire pour l’État et les pouvoirs publics, malgré tous les partis politiques, malgré la vindicte populaire, malgré les médias, malgré les fantasmes culturalistes, malgré Marx et son lupen prolétariat. En particulier pour les personnes dites roms, l’assignation est telle que l’on songe à la biopolitique mineure d’Agamben, c’est-à-dire à l’idée d’une subjectivation qui entraîne toujours et encore l’assujettissement. Ce n’est guère réjouissant. Mais on peut également penser à ce qu’Agamben écrit de Saint Paul, le « comme non » de l’usage pour sortir du statut et de l’assignation. Tu es marié, mais comme non marié, esclave, mais comme non esclave,... rom, mais comme non rom. L’imaginaire bohème produit un « comme si » Rom dont les travailleurs pauvres des bidonvilles peuvent faire usage pour produire leur « comme non ». Par delà les immeubles qui poussent, le quartier Confluence de Saint-Denis est aussi la possibilité d’un espace commun, un partage du sensible, des relations concrètes, amicales, affectives, professionnelles, une connexion des imageries, des imaginations en acte. Et un paradoxe fondamental. C’est la complexité et l’ambivalence de tout ceci qu’il s’agissait de relever.